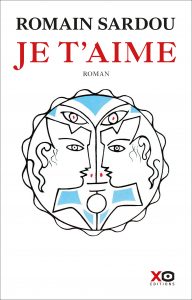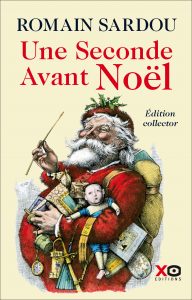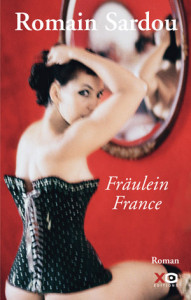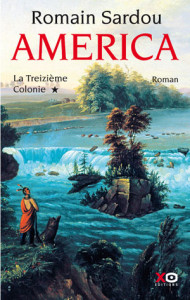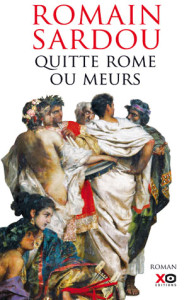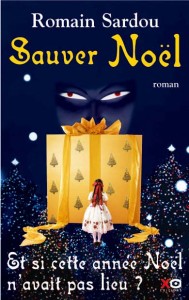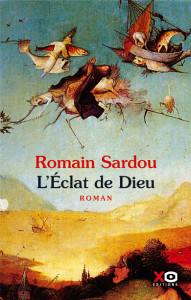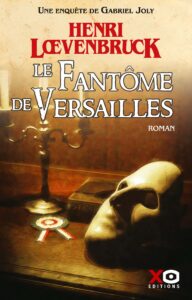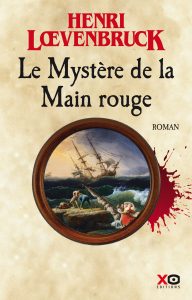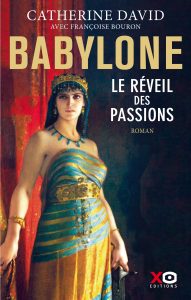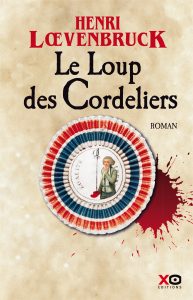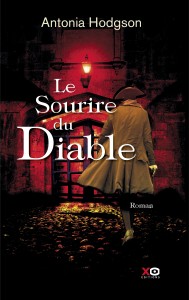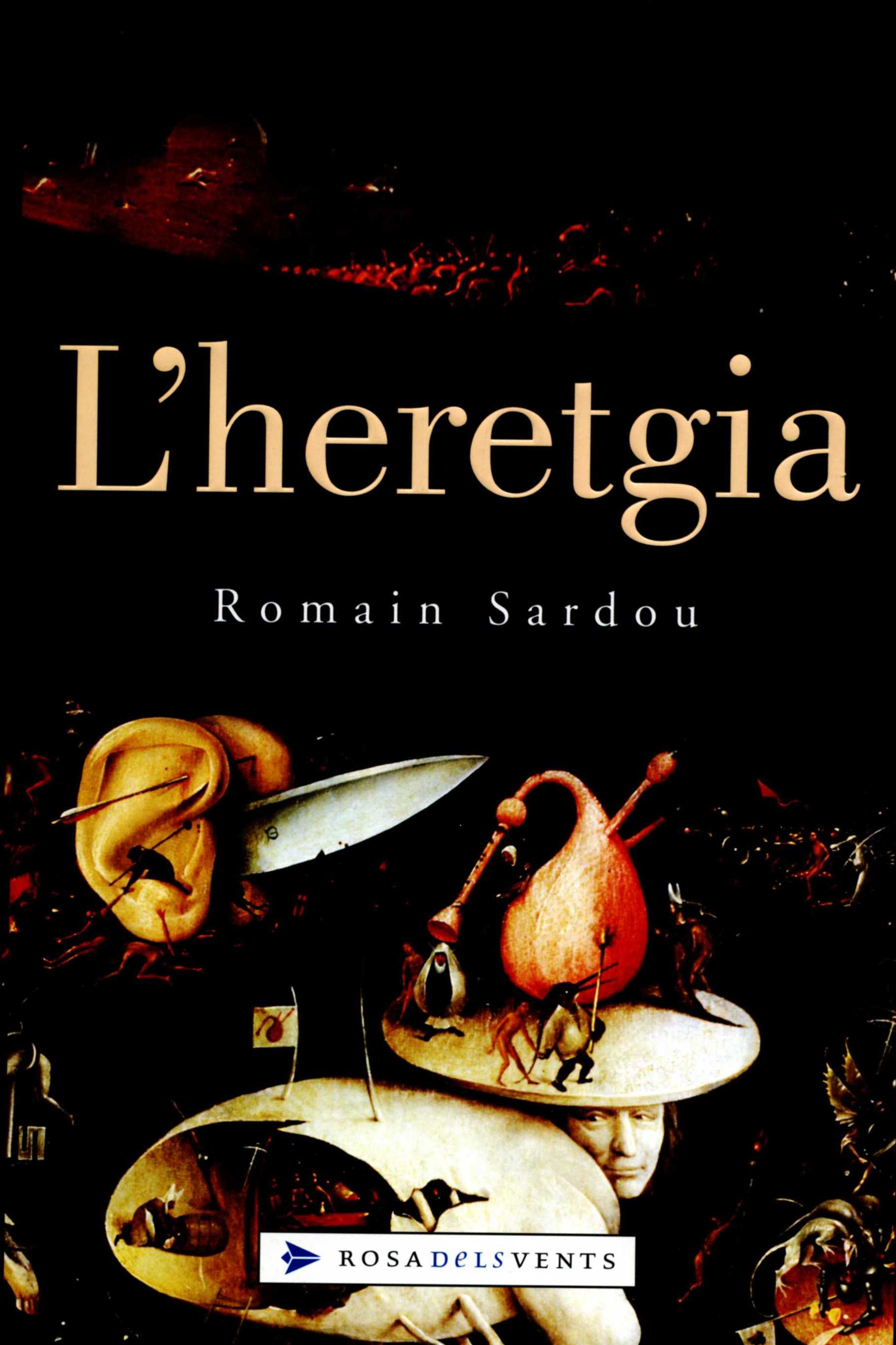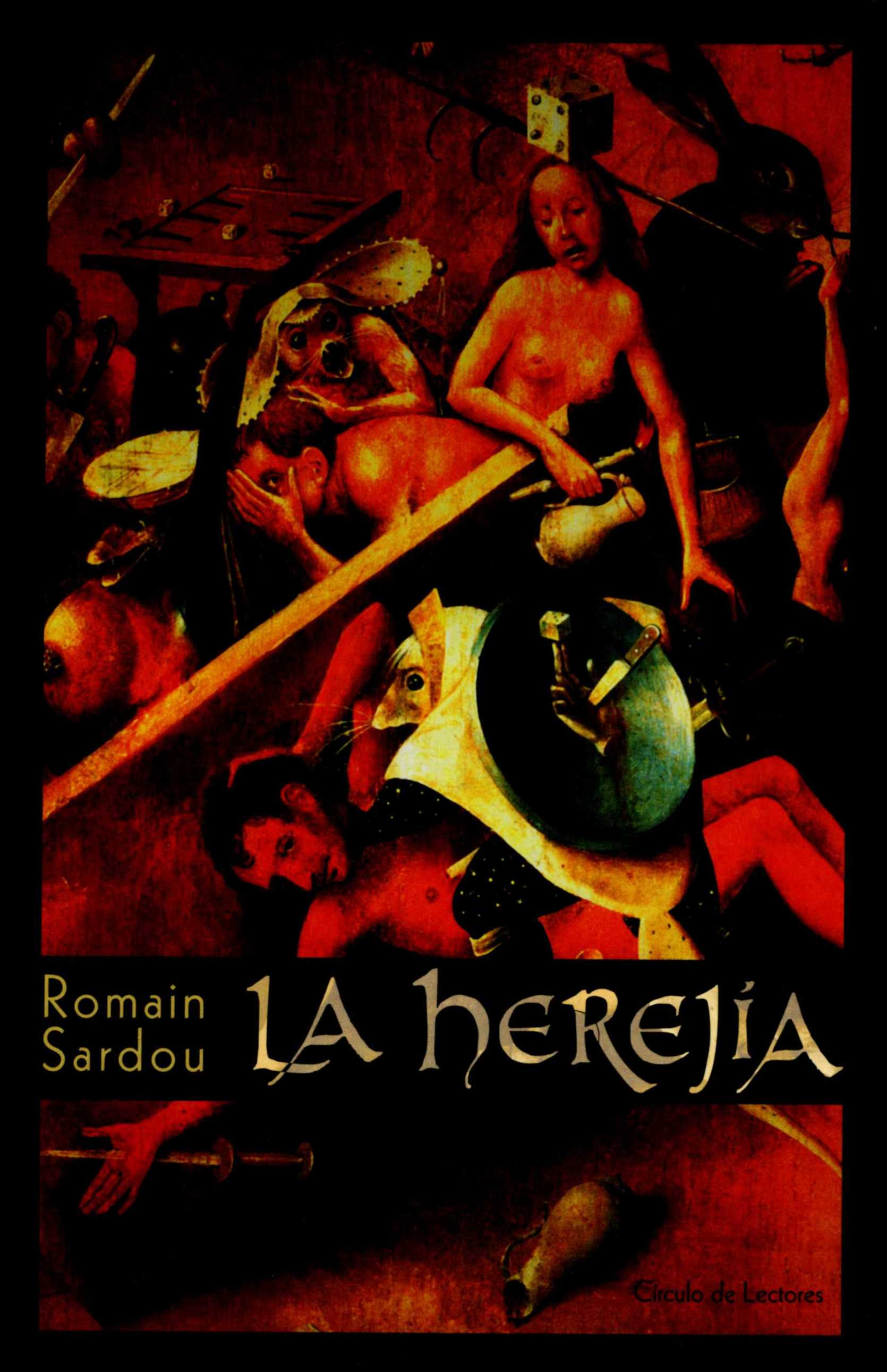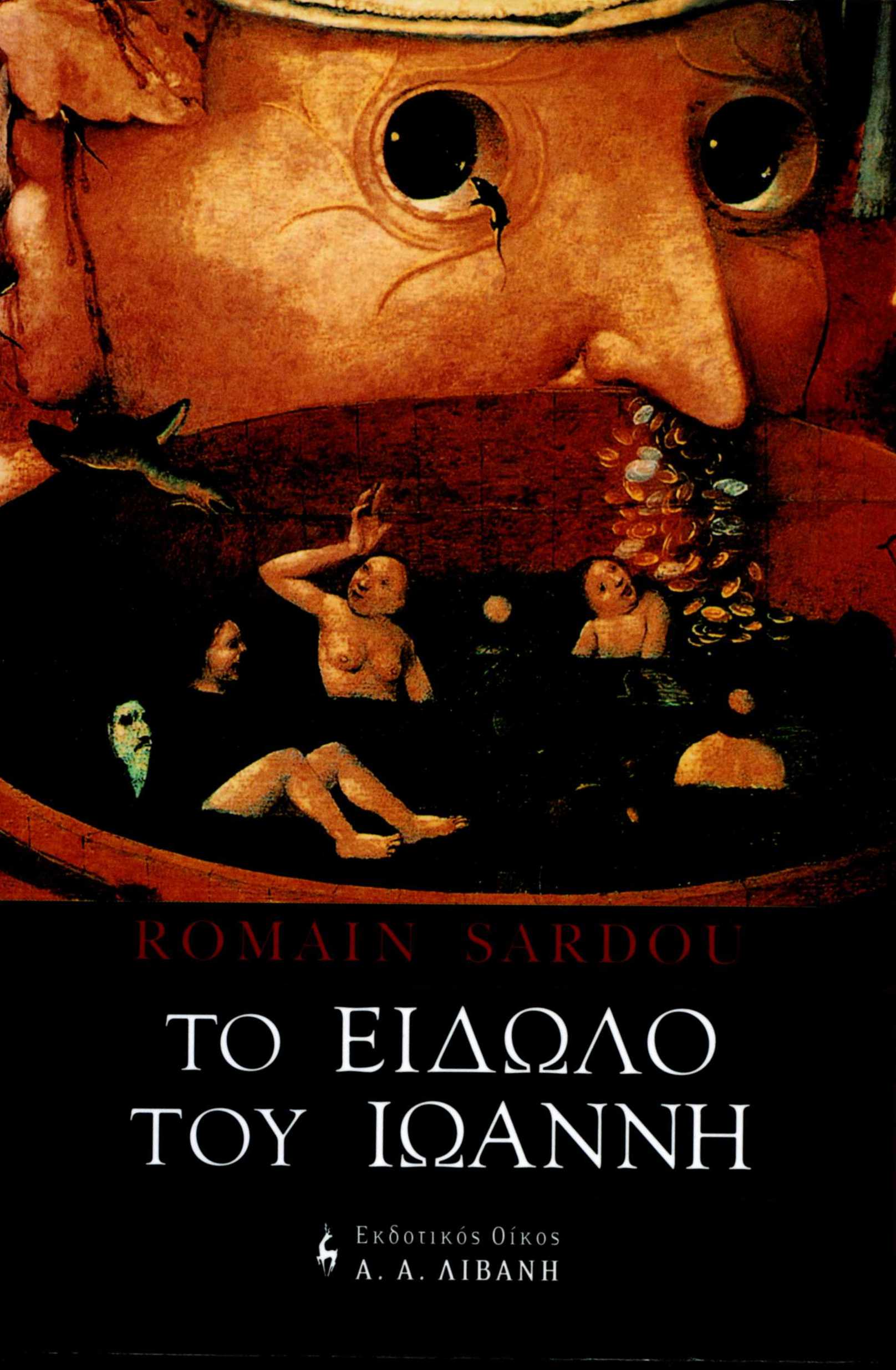Je suis venu à l’écriture par deux biais : la musique et le théâtre. C’est la musique qui a été ma première passion. J’avais à peu près 9 ou 10 ans quand j’ai entendu des opéras qui m’ont absolument fasciné. Donc, comme un gamin qui se dit « je veux être pompier », moi je me suis dit « je veux faire des opéras, comme Wagner ». C’est surtout Wagner qui me fascinait, parce qu’il écrivait ses textes et sa musique, il construisait sa mise en scène, il avait créé son théâtre… Je trouvais extraordinaire d’arriver à tout faire. Alors j’ai commencé à faire de la musique et à chercher des sujets pour écrire des opéras, et pour cela, je me suis mis à lire des pièces de théâtre. J’avais moins de douze ans, et à partir de là j’ai lu beaucoup de théâtre, Victor Hugo, Shakespeare, tout ce qui était classique je le lisais en me disant : « Est-ce que je peux en faire un opéra ? » Et puis je me suis rendu compte que le théâtre était beaucoup plus riche en situations, en événements, en histoires que l’opéra où il y a beaucoup de lourdeurs, de restrictions, et que je m’amusais beaucoup plus à lire une pièce de Victor Hugo qu’un livret de Da Ponte. Donc, comme le théâtre m’amusait plus, je me suis dit, bon, laissons tomber l’opéra, mon truc, c’est le théâtre.
Et le théâtre vous a conduit au roman ?
Oui, c’est toujours le même système, je me suis mis à lire des romans et ou des livres historiques en me demandant si je pouvais en tirer une pièce. Voilà comment j’ai découvert la littérature. Et puis je me suis mis à l’écriture théâtrale, tôt, j’ai beaucoup écrit mais beaucoup jeté parce que je ne réussissais pas à faire ce que je voulais. Je n’ai toujours pas réussi d’ailleurs, je continue, je m’accroche, mais il y a des contraintes qui font que ce n’est jamais vraiment ce que je veux. Donc, mon parcours pour arriver au premier roman, c’est opéra, théâtre, et roman au bout du compte.
L’envie d’écrire a donc occupé toute votre enfance ?
Oui, j’ai su très tôt ce que je voulais faire. L’école, je m’en foutais, parce que je préférais lire des pièces de théâtre. Alors j’ai arrêté assez vite, en première, avec cette ferme intention de devenir auteur dramatique. Mais j’avais du mal. Je n’arrivais toujours pas à maîtriser. Donc, quand j’ai quitté l’école, je me suis débrouillé pour entrer dans une école de comédiens, non pas pour devenir comédien moi-même, mais pour comprendre comment un comédien fonctionne, pour comprendre quelle différence il y a sur scène entre dire un texte de Racine et dire un texte de Voltaire. La principale différence, c’est que l’un écrit pour le théâtre, et l’autre « tente d’écrire pour le théâtre » comme le faisaient les classiques, alors le résultat n’est pas aussi fluide, pas aussi facile, pas aussi respiré, pas aussi magique. Et il me fallait comprendre ça de mon point de vue d’auteur. Comprendre ce qu’est une bonne pièce et une mauvaise pièce, une bonne tirade et une mauvaise, la ponctuation en tant que respiration. J’ai suivi ce cours pendant trois ans, où j’ai beaucoup appris.
Comment vos parents ont-ils réagi à votre volonté d’abandonner l’école ?
Ils m’ont soutenu. Dans une famille où la tradition artistique est aussi ancrée, on prend sans doute mieux ce genre de décisions que dans d’autres. Mes parents ont vu que j’étais très décidé, bon, à partir du moment où j’arrivais à me débrouiller… Et puis mon père ayant fait la même chose, il aurait eu du mal à m’envoyer « passer mon bac d’abord ». D’autant qu’il lit beaucoup, et que c’est dans sa bibliothèque que j’ai été pris par la passion de la lecture. Je ne dis pas que mes parents ne se sont jamais posés de questions, mais ils ne les ont jamais fait peser sur moi.
Pouvez-vous nous parler un peu plus de vos lectures, de vos passions, de ce qui a constitué petit à petit votre univers ?
C’est très disparate. Mais j’aime le romantisme avant tout, le XIXe siècle. Je trouve que c’est ce qu’il y a de plus agréable à lire quand on est jeune, parce que c’est de la littérature de grands enfants, où l’on se retrouve très bien, de Walter Scott à Eugène Sue. Je m’en suis nourri, et puis un livre en a amené un autre… Dès que je découvrais un auteur, je lisais sa biographie. Victor Hugo, Goethe, à chaque fois il fallait que je comprenne comment le type avait fait ça, ou comment il avait vécu pour en arriver à écrire ça. Puis les biographies m’ont elles-mêmes amené à l’histoire parce que je voulais savoir dans quelles circonstances vivaient les auteurs que j’aimais. Et de fil en aiguille, j’ai lu aussi les auteurs que eux aimaient – il y a beaucoup d’auteurs que j’ai découverts comme ça. Charles Nodier, je l’ai découvert parce que Victor Hugo le connaissait et l’admirait, et ainsi de suite.
Vous avez toujours cherché vos sujets plutôt dans la littérature classique ?
Oh oui ! Classique. Rien ne se passe au XXe siècle avec moi. Je n’écrivais que des pièces historiques, je ne choisissais que des personnages historiques. Pourquoi ? Je ne peux pas vous le dire. Une question de goût. Un roman avec un type qui entre dans la cuisine, ouvre son frigidaire et décapsule une bière, moi ça m’ennuie profondément. Mais dès qu’il entre dans un monastère fermé et ouvre un coffre défendu, là, ça m’intéresse. Le potentiel d’histoires et de personnages extraordinaires, je l’ai plus trouvé dans le passé que dans le présent.
Revenons à votre parcours. Vous avez donc 20 ans, vous sortez de l’école de théâtre…
… Et je n’ai toujours pas écrit de pièce. J’ai fait mon service militaire, j’avais 20 ans, 21 ans, je lisais énormément. Pendant mon service, on m’a d’abord surnommé Dostoïevski, parce que je lisais ses œuvres complètes, à chaque minute de libre. Vous imaginez l’appel : « Dostoïevski ! » « Présent ! » Ensuite on m’a appelé Dickens, pour les mêmes raisons. Bref, en sortant de l’armée, je me suis installé à la campagne, avec des livres, et j’y ai passé quatre ans. J’ai lu, énormément, et j’ai travaillé, j’ai voulu aller vers de nouvelles pistes qui me serviraient à écrire plus tard : j’ai travaillé avec deux amis qui concevaient des jeux de plateau, de télévision, des jeux vidéos ou d’ordinateur. Il faut savoir que la structure d’un jeu est assez extraordinaire. Vous partez de rien, d’un tout petit concept que tout le monde doit comprendre très simplement, et il faut imaginer tout ce que les joueurs peuvent penser ou tenter. Il ne faut jamais que le jeu finisse en quenouille. Il faut prévoir tous les effets possibles, toutes les règles, les sous-règles, les contre-règles. Et ça, cette mécanique de l’esprit, m’a passionné.
Et comment en êtes-vous arrivé à écrire pour Disney, aux États-Unis ?
Pendant deux ans j’ai travaillé sur ces jeux pour enfants, et pour plusieurs sociétés, dont Disney. Ensuite, je suis parti à Los Angeles écrire des scénarios de dessins animés pour les enfants. L’imagination requise pour écrire des histoires destinées aux enfants me plaît beaucoup, c’est très fourmillant d’idées, de petites références… Et surtout j’étais capable de les écrire ! Les dialogues sont assez simples. Si on m’avait demandé d’écrire un film new-yorkais avec deux Blacks du Bronx qui parlent entre eux, je n’y serais pas arrivé. Je suis resté là-bas un peu plus de deux ans, j’ai écrit de nombreux scénarios en free-lance. L’un d’eux a été acheté et m’a permis de vivre un bout de temps.
Qu’est-ce qui vous a ramené en France, finalement ?
D’abord j’allais me marier et je voulais me marier en France. Et surtout, j’avais le sentiment d’avoir fait le tour du peu que je pouvais accomplir aux Etats-Unis pour l’instant. Je ne me voyais pas écrire des romans en anglais, j’aime trop la langue française pour aller me colleter à l’américain. Au bout d’un moment, l’écriture de scénarii pour enfants a commencé à me peser, je n’étais pas dans mon univers, ce n’était pas du tout ce que je voulais faire, et ce n’était pas là que je voulais arriver. En revanche, c’est là-bas que je me suis mis à écrire des romans. Aux Etats-Unis, on écrit rarement un scénario directement, on écrit d’abord des grands synopsis, ce qu’ils appellent des traitements, qui peuvent faire une cinquantaine de pages. Et en écrivant ces traitements, je me suis aperçu que ça venait assez vite et assez bien, et qu’après cinquante pages j’aurais bien continué un peu… Pardonnez nos offenses est né à ce moment-là.
Le point de départ du roman, c’est la survivance des grandes peurs de l’an mil…
C’est la survivance des grandes peurs de l’an mil, et surtout le moment où la philosophie va commencer à mettre à mal les dogmes religieux, avec l’arrivée – le retour ! – d’Aristote et de l’esprit scientifique, au XIIe et XIIIe siècle. Tout d’un coup il y a des théologiens savants qui commencent à étudier les choses de l’homme et de la nature avec les outils de la science. Or ils ne sont pas censés les étudier, puisque le dogme chrétien leur dit : « ce n’est pas à vous de comprendre ces choses-là, contentez-vous d’être des humains, ce qui vous dépasse est censé vous dépasser, arrêtez-vous là ». Je schématise, mais c’est un peu ça. Et à cette époque, certains commencent à récuser cette vision des choses, par le biais d’Aristote qui prône l’expérimentation sur la vie. Donc on commence à étudier ce qu’on n’est pas autorisé à étudier, depuis le faisceau de la lumière jusqu’à la Trinité. Savoir si la Trinité est vraiment la Trinité, si le Fils est vraiment le fils du Père… Il y a un foisonnement intellectuel à cette époque qui est passionnant et très romanesque : à partir de cette volonté de tout étudier, on peut imaginer beaucoup d’expériences, de tests différents pour mettre à l’épreuve les croyances.
Les gens ont tout à coup senti un champ du possible ouvert devant eux ?
Les gens ont surtout commencé à avoir moins peur. Quand la science commence à démonter petit à petit certaines choses, des choses de la vie quotidienne, des maladies par exemple – la maladie, jusque-là, c’était quelque chose qui dépendait de Dieu, et tout à coup quelqu’un arrive avec une herbe et hop ! on guérit. Ce n’est plus religieux, ce n’est plus divin, et les peurs se sont peu à peu déplacées, elles n’ont plus été les mêmes, et elles se sont laïcisées en quelque sorte. Elles ont commencé à sortir du giron de l’Église en tout cas, et inévitablement, ça s’est mal passé.
Votre roman met en scène les manœuvres d’une assemblée secrète au sein de l’Église. Est-ce pure invention ou appuyé sur des éléments historiques ?
C’est pure invention, mais de l’ordre du possible. Il y avait une contestation au sein de l’Église, entre les conservateurs qui refusaient toute mise à l’épreuve des textes par la science et d’autres qui pensaient au contraire que la science pourrait éclairer les textes. Ce n’était d’ailleurs pas le seul mouvement de contestation à l’époque. Il y avait aussi les Cathares, par exemple. C’est étonnant, parce qu’au XIIIe siècle l’Eglise n’a jamais été aussi puissante et jamais autant en danger. Mais le pouvoir romain était fort, ils ont eu deux papes indestructibles et très stratèges qui ont réussi à étouffer tous ces mouvements. Donc, l’assemblée secrète, le « convent de Meggido », aurait pu exister. Si un jour la bibliothèque du Vatican ouvre ses archives, on verra ce qu’il en est !
Il y a eu une redécouverte du Moyen Age au XIXe, avec la naissance du roman historique… Vous vous en sentez proche ?
En fait il y a eu deux découvertes du Moyen Age. Le XIXe l’a idéalisé, on a alors du Moyen Age une idée romanesque, très éloignée de ce qu’il a été, mais très visuelle, très sonore, très romantique. Et puis la deuxième découverte, c’est celle du XXe, beaucoup plus scientifique. Au XXe les historiens ont dit : « il faut arrêter de voir le Moyen Age avec des gens ébouriffés, des gens crasseux, et le mal partout », ils sont rentrés dans le quotidien des gens, dans une véritable ethnologie, secteur par secteur, activité par activité, et là on découvre une monde totalement différent, moins superstitieux qu’il ne l’est chez Michelet, mais en tout cas riche d’enseignements extraordinaires. Avoir accès aux deux pour écrire un roman, c’est le rêve. Je pense qu’Alexandre Dumas aurait été ravi d’avoir lu Le Goff, Le Roy Ladurie ou Duby. Il en aurait tiré des passages fabuleux. Moi, je me situe entre les deux visions. Là où il faut du romanesque, je n’hésite pas à y aller franchement, et en revanche quand il y a des détails, je vais les chercher là où est la certitude scientifique.
Dans votre roman, les femmes ont des rôles très éloignés de ceux des hommes. Comment voyez-vous la femme à cette époque ?
Dans le roman, j’utilise seulement quelques « types » de la femme de l’époque. La paysanne, d’abord, qui n’a pas beaucoup de latitude, ce n’est pas un siècle très féminin, il est plutôt fermé et patriarcal. Il y a peu de place pour les femmes, à part dans la maison. Le Roy Ladurie le montre : les femmes sont au centre de ce qui se passe dans la maison, elles sont bien présentes. Plus puissantes qu’on l’imagine. Mais dans la société, leur rôle reste restreint. Cependant, les grandes dames commencent à acquérir une certaine culture, voire à écrire. C’est là où elles se mettent à faire des poèmes, des tapisseries, de la musique. Elles se réveillent, timidement, même si c’est surtout vrai au XIVe.
Il y a quand même un phénomène étonnant, que j’utilise dans le roman, qui est le moment où tous les hommes partent pour les croisades, surtout la septième, celle qui va durer parce que Saint Louis est fait prisonnier pendant plusieurs années avec tous ses chevaliers. Tous les seigneurs de France valides et puissants sont donc loin de chez eux. D’habitude l’Eglise prenait la place tout de suite, dès que les hommes partaient pour les guerres d’été. Mais là, les femmes ne se laissent pas faire et se mettent à organiser, gérer les domaines, les terres, les conflits. D’ailleurs l’exemple de la régente Blanche de Castille est très fort. Elle gère le royaume toute seule pendant que son fils est prisonnier. Et quand les maris reviennent, ils se retrouvent avec des femmes beaucoup plus alertes, qui ont même parfois fait les choses bien mieux que ce qu’ils auraient fait.
Les autres femmes qui apparaissent, ce sont les filles en bleu, divinités de la forêt.
Là, c’est tout à fait différent. Elles symbolisent une réalité de l’époque : au XIIIe siècle, l’Eglise est à son apogée, mais elle n’a quand même pas la vie facile. Les superstitions, les pensées païennes, le paganisme sont encore très profondément ancrés dans les esprits. Les gens ont accepté le Christ, mais ils le mâtinent avec les croyances de leurs ancêtres. Ils font coexister très simplement le Christ et les divinités de la région, qui habitent telle pierre ou telle source magique. L’Église tente de mettre un saint sur la fontaine, de christianiser tout ce qui peut l’être, mais elle a encore du mal. Ces filles qui apparaissent dans le roman représentent toutes ces pensées, toutes ces divinités que l’Eglise a balayées, mais qui ont la vie dure. Elles faisaient encore partie du quotidien des gens. On ne balaye pas des siècles de croyances, et je voulais qu’elles soient là, au milieu de ce capharnaüm du roman.
On sent que vous avez un univers intérieur complexe, un imaginaire foisonnant… Comment qualifieriez-vous votre roman ? Et y en aura-t-il d’autres ?
Oui, bien sûr, il y en aura d’autres. J’ai beaucoup d’idées dans mes tiroirs. Quant à qualifier le roman… On pourrait dire que c’est un policier, ou un roman à mystère. Ce qui prime, pour moi, c’est l’intrigue et les personnages. Partir d’une idée un peu complexe – ici cette irruption d’Aristote dans la pensée chrétienne –, et l’adapter, la simplifier, la faire vivre à travers des personnages jusqu’à ce qu’elle « passe toute seule ». C’est un roman, je ne peux pas mieux dire.