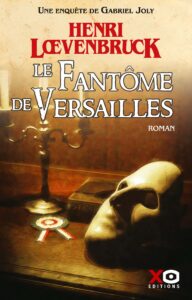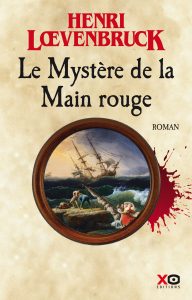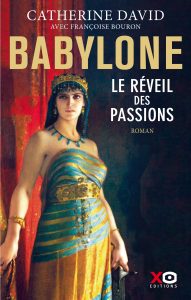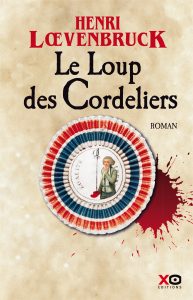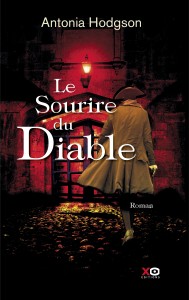Les derniers jours de Paris est une sorte de roman catastrophe qui raconte la résurgence des origines secrètes de Paris, sous la forme d’une crue monstrueuse de la Seine. C’est un Paris mystérieux qui se réveille, une ville où des animaux circulent en liberté dans les rues… Dans cette panique générale je jette mes personnages, un jeune prof d’histoire à la Sorbonne et une adolescente surdouée de 14 ans. Tous deux enquêtent de la ménagerie du Jardin des plantes aux catacombes, du Père-Lachaise aux stations de métro fantômes, suivant un itinéraire de plus en plus inquiétant… En un mot : Paris n’a plus que quelques heures à vivre, peuvent-ils la sauver, et comment… ?
Quand je découvre un lieu (et quand je commence à l’aimer), je suis toujours en quête de ce qu’il y avait avant. J’aime les vieilles maisons restées dans leur jus, les ruines, les livres d’occasion, les brocanteurs poussiéreux. Avec Paris, ce fantasme de la recherche des origines est pour moi poussé à l’extrême. Étant parisien moi-même, je vis dans une ville habitée depuis des milliers d’années, et dont on peut lire l’histoire comme les couches successives d’un gâteau. Tranche après tranche, on passe de la préhistoire aux conquêtes romaines, du Moyen-Âge aux Lumières, d’Haussmann à Jean Nouvel… C’est passionnant ! Et c’est la permanence de la ville ancestrale malgré sa nécessaire évolution qui me fascine. Savoir que de mon immeuble partaient, quatre siècles plus tôt, les coches pour Rouen, voilà qui excite mon imagination. Ils frôlaient les mêmes murs, regardaient le même ciel. Bref, Paris – comme Rome – est une ville éternelle, et c’est cette éternité instillée dans le présent que je cherche à figer, comme on tente de photographier un spectre en plein jour !
Votre précédent roman, Les Orphelins du Mal, traitait du destin d’enfants nés dans les Lebensborn nazis. Et on retrouve dans ce nouveau roman le leitmotiv du questionnement autour des origines mensongères, de la filiation brouillée. D’où vous vient cette obsession ?
Je vous rassure tout de suite : je sais qui sont mes parents (du moins, je crois…). Je suis même issu d’une famille qui remonte assez loin dans le temps. C’est sans doute pour ça que l’idée même de famille, de clan, de lignée, me passionne. J’ai été élevé au beau milieu de ma famille (parents, grands-parents, tante etc.) ; nous vivions tous dans la même maison où j’ai pendant longtemps été l’enfant roi. Je suis resté très proche des miens, j’ai pour habitude de les voir souvent, de passer mes vacances avec eux, de les appeler très (trop ?) souvent. Est-ce par nostalgie, par devoir, par amour ? Tout ça, sans doute. C’est en tous cas une façon bien à moi de recréer ce lien permanent entre passé et présent…
Vous évoquez magnifiquement la résurgence de la nature sauvage dans l’univers urbain. Qu’y a-t-il de vrai là-dedans, et d’où vous est venue cette inspiration ?
Il n’y a ni vrai ni faux, il n’y a qu’une question de regard et d’angle de vue. Promenez-vous au Jardin des plantes, au Luxembourg, à Montsouris, aux Buttes-Chaumont, au Père-Lachaise, un beau jour de mai. Tâchez d’oublier la ville environnante et concentrez-vous sur le parfum des lilas, celui des roses, le vent dans les feuilles des marronniers, la brise qui caresse les herbes, le frisson du lierre, de certaines fougères… Lorsque vous relevez les yeux, c’est la ville qui vous paraît un monde de science-fiction. Mon livre est né de cette sensation, de ce contraste à la fois effrayant et excitant.
Justement, dans quel genre votre roman, qui démarre dans le Paris d’aujourd’hui pour basculer dans l’imaginaire, s’inscrit-il ? Fantastique ? Littéraire ? Suspense ?
Je pense qu’il est à la croisée des genres et des chemins, comme le sont tous mes livres, en fait. L’un de mes modèles est René Barjavel, qui écrivait des livres dits « de genre » avec une rigueur littéraire et une élégance uniques. Je pourrais aussi citer Pierre Véry dans le domaine policier : Les Disparus de Saint Agil ou L’Assassinat du père Noël sont des chefs d’œuvre. Mais sous prétexte qu’ils relèvent du divertissement, on les déprécie. Voilà qui est injuste. La classification est un virus très français. Chez les Anglo-Saxons ou les Latins, la frontière entre les genres est beaucoup plus souple. Regardez la variété de l’inspiration de Stephen King, qui passe de l’horreur pure de Carry à la nostalgie de Cœurs Perdus en Atlantide. Et je ne parle pas de Borges ou de Bioy Casares… Alors c’est vrai, sans être fantastique au sens strict ce livre bascule dans l’irréalité. J’ai toujours une tendance à l’irrationnel, dès qu’il s’inscrit dans la réalité la plus tangible, voire la plus prosaïque ou la plus vulgaire. Au cinéma, j’aime les films qui plongent dans la folie mais commencent de façon quotidienne, comme ceux de Polanski (Rosemary’s Baby ou Le Locataire). C’est la même chose avec les livres. Je ne peux m’empêcher d’être contaminé par un réalisme fantastique qui surgit presque malgré moi, mais qui est l’aboutissement logique d’une réalité parfaitement crédible. Vous croyez que je suis fou ?
On sent une documentation fouillée derrière ce livre. Paris est-il un thème qui vous obsède depuis longtemps ?
Je pourrais dire depuis toujours. Mes parents ont divorcé quand j’étais très jeune et je vivais avec ma mère dans l’Oise. Un week-end sur deux, je rejoignais mon père à Paris, et il a toujours eu soin de m’emmener marcher dans la ville, me faisant découvrir ses rues, ses musées, ses recoins cachés. À sa façon, il a éveillé ma sensibilité parisienne, en me montrant certains lieux qui pouvaient aussi ressembler à ceux que je connaissais en province, des vieux immeubles, des cours pavées, des ruelles étroites. Tout mon imaginaire parisien est né ainsi. Et Paris n’a jamais cessé de me hanter. Des livres comme Le Guide du Paris Mystérieux ont toujours excité mon imagination gourmande de légendes urbaines. Et des auteurs comme André Hardellet, qui fait partie des derniers vrais piétons de Paris, m’ont appris à regarder la ville sous un autre angle : celui de la poésie en mouvement. Attention : Les derniers jours de Paris n’a rien d’une fresque poétique ; mais ce roman catastrophe est né d’un regard décalé sur une ville et son histoire mythologique.
Le roman évoque la Bièvre. Qu’était cette rivière, dans la réalité, et où est-elle passée ?
La Bièvre est un fantasme qu’on a sans doute trop magnifié. Il s’agit d’une rivière qui prend sa source près de Guyancourt dans les Yvelines. Dans sa forme originale, elle traversait Paris par le sud, se jetant dans la Seine non loin de la Gare d’Austerlitz. Mais à mesure que Paris est devenu une métropole, la Bièvre s’est transformée en ignoble égout à ciel ouvert, car elle était longée par les tapissiers, les tanneurs, les blanchisseurs, les mégissiers, qui jetaient dans son cours leurs ordures. Au début de la IIIe République on a finalement décidé de la couvrir, ce qui a pris plusieurs dizaines d’années. Toute la physionomie du sud-est parisien a été changée, car il a fallu remblayer ce qui était la « vallée de la Bièvre ». De nos jours, elle s’engouffre sous terre au niveau d’Antony, en banlieue sud, et se mêle aux égouts… D’aucuns rêvent de la ressusciter, mais cela demanderait des travaux considérables pour ce qui doit rester un rêve nostalgique…
Êtes-vous déjà descendu dans les catacombes parisiennes que vous évoquez ?
Parmi les lieux étranges où mon père me conduisait souvent, il y avait bien sûr les catacombes de la place Denfert-Rochereau. Ces alignements de six millions de crânes ont de quoi marquer à vie un gamin, croyez-moi ! Mais ces quelques kilomètres d’ossuaires ne sont rien à côté de l’immensité des carrières de pierre qui courent sous Paris. J’y ai, pour les besoins de mon livre, passé une folle journée, un hiver. Après huit heures dans le noir absolu, l’humidité de la nappe phréatique et la tiédeur du sous-sol parisien, retrouver l’air libre sur les rails désaffectés de la petite ceinture a comme un goût de renaissance. Une expérience unique !
Comment conciliez-vous l’écriture de vos romans avec votre métier de journaliste bien ancré dans la vérité des choses ?
Comme je l’ai dit, j’aime être à la croisée des genres, parfois imprévisible. Si j’écris des romans un peu fous, je suis aussi critique de cinéma, de livres et (surtout) de musique classique. C’est au contraire une chance merveilleuse que de pouvoir passer la matinée dans un monde secret, avant de fermer son ordinateur pour courir dans une salle de projection, puis filer interviewer un chef d’orchestre pour finir sa journée à l’opéra… La diversité est ma respiration. Ce n’est pas du dilettantisme, c’est de l’ouverture d’esprit, de la gourmandise…
Quels sont vos projets d’écriture maintenant ?
Après avoir longtemps hésité, je vais repartir vers mon péché mignon : le roman historique. Le succès des Orphelins du Mal me pousse à explorer à nouveau cette période si riche de la Seconde Guerre mondiale. Et le fait que mon histoire familiale soit mêlée à celle de la Résistance m’a soufflé une grande fresque autour de l’Occupation, dont je suis en train de bâtir le plan. Mais ça, c’est une autre histoire…