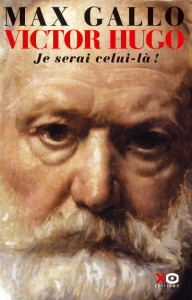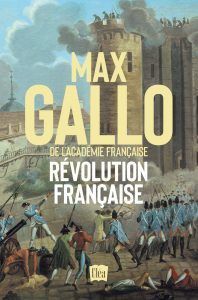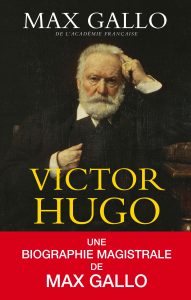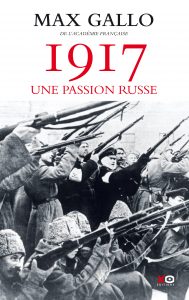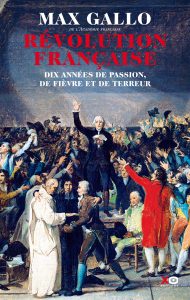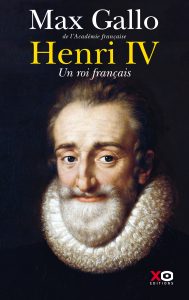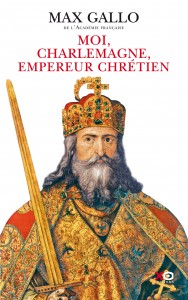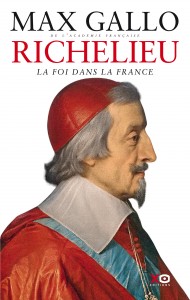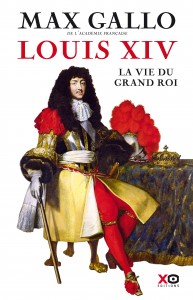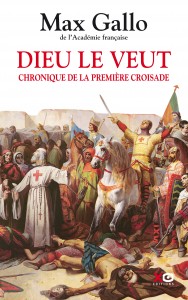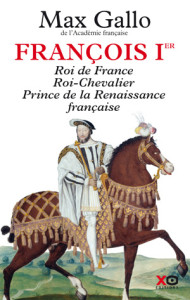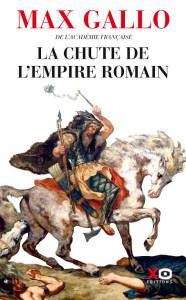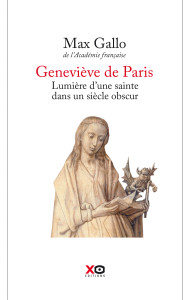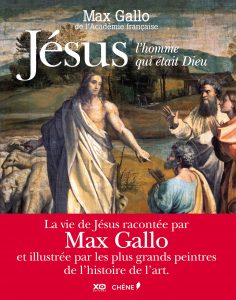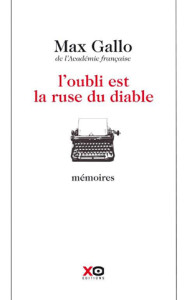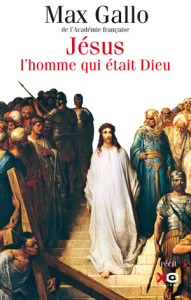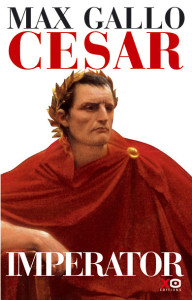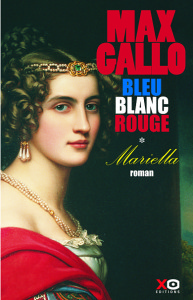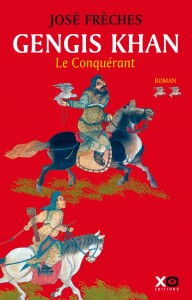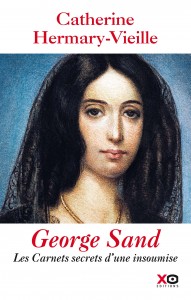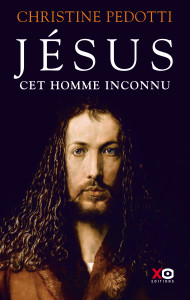Max Gallo : C’est en effet une réflexion pertinente que de comparer Hugo à un monument public. Par le fait, il domine le paysage comme la Tour Eiffel domine la capitale… Alors comment fait-on pour s’immiscer à l’intérieur ? Eh bien, on l’escalade ! Mais il faut commencer par les fondations, autrement dit la famille. Et c’est là que l’on découvre des fêlures, des difficultés dès l’enfance. Ensuite, il faut suivre le chemin pas à pas et c’était ça l’idée, le plan du livre, suivre d’année en année le déroulement de sa vie, en constatant qu’il existe une intrication très forte entre les événements de sa biographie et son œuvre. Je me suis donc servi de l’œuvre pour éclairer la réalité de sa vie, et dans le sens contraire, de sa vie pour éclairer l’œuvre…
M. G. : En effet, on trouve aussi bien dans Les Contemplations que dans L’Art d’être grand-père, et dans la plupart de ses œuvres, beaucoup d’éléments biographiques, par exemple sur le voyage en Espagne qu’il a effectué quand il avait neuf ans. Mais c’est vrai que la correspondance, soit avec Juliette Drouet, qui est abondante, soit avec sa femme Adèle, qui l’est aussi, le livre d’Adèle elle-même — bien sûr hagiographique—, Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, les lettres adressées à Vigny, à Sainte-Beuve, etc., tous ces documents permettent d’avoir plusieurs points de vue sur l’homme, et vu sous des angles divers, de réussir à refaire vivre ce personnage dans sa complexité.
Nous faisons donc sa connaissance lorsqu’il est un enfant…
M. G. : Un enfant déchiré entre ses parents qui sont très violemment opposés l’un à l’autre. Lui-même dit : Je n’ai jamais connu qu’un tronçon de famille… On pourrait presque affirmer qu’il a été abandonné tout petit, même si le terme est un peu fort, par sa mère. En tout cas, il a été confié avec ses deux frères, Abel et Eugène, à son père, un officier en garnison à Marseille, puis en Corse, puis dans l’Île d’Elbe notamment… On a des lettres du père qui racontent l’enfant pleurnichant dans un coin, et le père écrit à la mère : « Victor t’appelle toujours… » Ensuite, il a vécu la situation contraire, la mère récupérant ses enfants, et le père refaisant sa vie avec une autre. Avec à ce moment-là l’entrée d’un nouveau personnage, le général Fanneau de Lahorie, qui est manifestement l’amant de la mère. Lahorie vit caché, puisqu’il a participé à des conspirations contre Napoléon, mais il offre une éducation aux enfants, enseigne à Victor les poètes latins. Il a l’image d’un héros. D’un côté le vrai père, officier sous Napoléon, fait comte de Siguenza en Espagne mais absent, de l’autre ce général de Lahorie, que Napoléon va faire fusiller… On comprend mieux alors cette opposition de jeunesse entre l’amour de Hugo pour sa mère et le rejet du père, qui se manifeste par le rejet de Napoléon. C’est la période où il est ultra royaliste. Puis, après la mort de la mère, en 1821, le père revient, et l’Histoire aussi évolue… En se réconciliant avec son père, Hugo change son regard sur l’Empereur… Tout en restant critique sur bien des points, Napoléon devient pour lui le personnage qui occupe, à juste titre, tout le XIXe siècle, et c’est une façon de dire : j’ai retrouvé mon père…
Entre-temps, Hugo s’est mis à écrire… Et très tôt, il cherche à être reconnu.
M. G. : D’abord la phrase célèbre, à 14 ans : Je veux être Chateaubriand ou rien. Ce qui donne déjà la mesure de son ambition, puisque cela signifie : ou je suis l’égal du premier — Chateaubriand dominait de sa stature la Restauration, homme politique, ministre, poète, académicien, bref tous les attributs de la gloire littéraire, sociale et politique en même temps — ou bien le néant… Il le dit très clairement dans un poème : Gloire ! ô gloire, sois mon idole… Mais il y a aussi une autre raison, qui est l’aspect financier. Car, comme il le dit très ouvertement : Obligé par le malheur des temps de faire à la fois une œuvre et une besogne…, il doit gagner sa vie. Il se marie avec Adèle à vingt ans et, avant d’avoir un appartement, il faut qu’il habite chez ses beaux-parents. Ce sont des détails apparemment sordides mais qui comptent ! Et pour vivre grâce à ses livres, qui sont d’abord des livres de poèmes, eh bien il est très heureux de toucher des subventions de la monarchie… Le sacre de Charles X, par exemple, pour lequel il va toucher mille francs — ce qui est beaucoup pour l’époque ! — représentant à la fois ses frais de voyage et une subvention pour écrire une Ode, c’est en effet un système qui peut séduire un jeune homme de vingt-trois ans ayant besoin d’argent ; et c’est aussi une façon de conquérir la gloire, puisque ce texte va être imprimé par l’Imprimerie nationale et qu’il obtient la Légion d’honneur. Le voilà, dit Stendhal, « véritable poète du parti ultra ». À ce titre, il n’est bien vu ni par les bonapartistes ni par les républicains !
À quel moment et pourquoi change-t-il d’opinion politique ?
M. G. : C’est un parcours intéressant. En 1825 donc, il est celui qui flatte Charles X, un gouvernement vraiment « ultra »… Puis, quand surgit la révolution de 1830, il devient le chantre de Louis-Philippe d’Orléans, qui a chassé Charles X… Et il va chanter le souvenir des morts des journées de juillet : Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie /Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie. Il va être alors vraiment dans le cercle rapproché de Louis-Philippe, jusqu’à ce qu’il soit nommé par ce dernier pair de France, l’équivalent en un peu plus prestigieux d’un sénateur… L’élite en quelque sorte, et il entre à l’Académie française par la même occasion… Là, il prononce un discours qui est reçu comme un discours politique, comme un acte de candidature à une fonction officielle, et tout le monde pense, dans les années 1841-1842, que le destin de Victor Hugo est d’être un jour membre du gouvernement. Mais arrive la révolution de 1848, et c’est pour lui un barrage, puisque c’est Lamartine qui devient membre du gouvernement provisoire !
Son grand changement politique et social, il le réalise entre 1848 et 1851. Pendant cette période, il est élu député et il va devenir — au nom de ses principes, parce qu’il a découvert la pauvreté, parce qu’il a assisté aux émeutes des ouvriers en juin — légaliste : il veut des lois contre la misère dont il a vu combien elle était profonde… Et sa réelle mutation se produit au moment du coup d’État où il va s’opposer très courageusement à Louis-Napoléon Bonaparte dans ces journées du mois de décembre 1851, où il risque vraiment sa vie et où, probablement, des spadassins le cherchent pour l’assassiner. Là il est contraint à l’exil, qui va durer dix-neuf ans, et devenir ainsi le symbole de l’opposition au Second Empire. En 1870, quand il rentre en France, il incarne la République, tout un symbole qui se termine en apothéose par les honneurs, poste de sénateur, etc., honoré comme le grand poète national.
C’est un parcours qui suit les évolutions de la société française, et dans lequel la mort de sa fille, en 1843, a joué un rôle essentiel. Il a senti brusquement que, finalement, les honneurs, la gloire, l’argent, n’ont pas grand sens…
Il faut avouer que le destin n’a pas été très tendre avec lui…
M. G. : Il est vrai que c’est un homme qui voit souvent la mort frapper autour de lui. Bien sûr, ses parents, mais aussi ses enfants : un premier-né qui meurt après quelques semaines, puis sa fille chérie, Léopoldine, qui se noie avec son jeune mari, puis ses deux fils, qui meurent avant lui. Si bien qu’il se sent cerné, avec cette interrogation : Qui sait si tout n’est pas un pourrissoir immense ? Quand on le côtoie pendant un certain nombre d’années, on se rend compte que c’est un homme très complexe, contradictoire. Il y a en lui d’abord une énergie qui passe par-dessus les chagrins que la vie lui impose, et il vit en même temps dans un désespoir très profond.
Mais il semble trouver un peu de paix en exil…
M. G. : Je pense que tout le monde a besoin, à un moment ou à un autre de l’existence, d’unifier sa vie. Et c’est ce qu’il a fait en exil. Dès 1848, il a fait un choix et il s’y est tenu, il a été fidèle lui-même, a assumé son opposition, même si cela lui coûte cher. Alors il se sent bien, il travaille beaucoup, et les livres dans lesquels il a exprimé son indignation réussissent à passer en France, même Les Châtiments, même Napoléon-le-Petit… Les Contemplations sont un immense succès, ne parlons pas des Misérables, publié en 1862. Donc il est tranquille sur le plan financier, car il tient à son indépendance et sa sécurité matérielle… Il écrit à sa femme : « Les Misérables sont une affaire pour nos enfants… » Et il n’a jamais été dans le besoin mais il craignait beaucoup de l’être… Et puis il y a l’océan, le vent, une nature dans laquelle il se sent à l’aise. Il se baigne tous les jours, il prend des douches froides, après se frictionne au gant de crin, il marche… Et donc il atteint une sorte de bonheur — le mot est peut-être excessif — disons de plénitude… Et en même temps il avoue, et ça n’est pas du jeu chez lui, que l’exil c’est la mort, qu’un exilé est mort.
Car il faut aussi prendre en compte le fait que dix-neuf ans, c’est très long. Il y a là sa fille Adèle, qui sombre dans une folle passion pour un lieutenant anglais qui ne veut pas d’elle — elle quitte l’île pour le suivre… — et ça c’est une souffrance, d’autant que l’un de ses frères est mort fou. Il y a ses fils qu’il entretient, car il fait vivre dix personnes au moins autour de lui, Juliette, sa femme Adèle, les compagnes des fils, les bonnes… Or, peu à peu, son entourage s’éloigne, les gens ont envie de retrouver Paris, ou Bruxelles… Lui a souvent des cauchemars, des maux de tête, ça n’est pas une condition simple, il reste ce qu’il est, un tourmenté, un angoissé… Et puis il y a le temps qui pèse sur lui, moins que sur les autres d’ailleurs, puisque, comme dit sa femme, il est dans une forme superbe, de plus en plus vigoureux, de plus en plus beau…
Nous n’avons justement pas encore parlé des femmes…
M. G. : Victor Hugo et les femmes ! C’est un sujet classique, mais plus complexe qu’il n’y paraît. Il faut d’abord penser à la relation qu’il a eue avec sa mère, une véritable adoration pour elle, qui lit ses premiers textes, qui l’approuve, auquel il dédie la première tragédie qu’il écrit… Ensuite, il a ses amours enfantines, que ce soit en Espagne où il est fou amoureux d’une femme de général et aussi de la petite fille d’un marquis, Pepita…, ou à Paris, où Adèle, la fille d’amis de sa mère, devient bientôt son unique compagne de jeux, et qu’il épousera à vingt ans, alors qu’ils sont vierges tous deux ! Il dira plus tard que, fort d’une virilité exceptionnelle, il lui a fait neuf fois l’amour lors de leur nuit de noces. Vrai ou faux, qui peut le savoir… En tout cas, il va rester fidèle une dizaine d’années, mais au fur et à mesure que la gloire le touche, qu’il écrit des pièces de théâtre, et donc qu’il fraie, beau et célèbre, avec ce monde des comédiennes, il découvre un autre univers.
Il hésite un peu puis, finalement, il va connaître sa première maîtresse, et une relation passionnelle de toute une vie, avec Juliette Drouet, petite actrice et modèle d’un sculpteur, femme de petite vertu, avec laquelle il va découvrir l’amour physique, une femme experte, dirons-nous… Au-delà, Juliette a un peu joué pour lui le rôle qu’a joué Joséphine de Beauharnais avec Bonaparte, celui d’éducatrice. Mais à la différence de Joséphine, elle voue à Hugo (son Toto !) une adoration absolue, elle a l’impression qu’il est Dieu, qu’il est son rédempteur, que l’amour qu’elle lui porte efface tout son passé tumultueux et qu’il est le dernier homme de sa vie. Ce qui sera le cas. Elle va vivre cloîtrée — car il la cloître, il est très dur avec elle parce qu’il lui reproche son passé — et elle recopie ses manuscrits. Ils auront une relation de cinquante ans.
Ensuite, deux ou trois ans après leur première nuit qui a déclenché chez lui un enthousiasme absolu : Je suis la barque errante et vous êtes la voile…, parce qu’il a découvert sa propre sexualité, et son besoin des femmes, du corps des femmes, des jeunes femmes, il va être l’homme qui va… Et cela s’accélère au fil de sa vie, avec parfois des engouements violents, comme avec cette Léonie d’Aunet, vingt-cinq ans, avec laquelle il trompe Juliette, avec laquelle aussi il va être surpris en flagrant délit d’adultère, parce que le mari a porté plainte !
Vieillissant, il ne cessera plus ses fredaines, jusqu’à avoir deux activités dans sa journée, d’une part écrire, d’autre part trouver des femmes… Ces femmes, qui sont-elles ? De toutes sortes ! Depuis la prostituée qu’il paie, jusqu’à la bonne qu’il paie aussi… Des petites bonnes consentantes, auxquelles il apprend à écrire, à lire, dont il a envie de caresser les seins, de voir les jambes… Est-ce qu’avec le temps, il n’est plus que voyeur ? Quoi qu’il en soit, Juliette découvre à plusieurs reprises qu’elle est trahie, lui se sent tout à fait coupable, il promet de ne pas recommencer et il recommence toujours, même avec des jeunes femmes que Juliette elle-même lui présente pour écrire ses manuscrits parce qu’elle a les mains paralysées par les rhumatismes… Juliette qui, lorsqu’il a une petite congestion cérébrale en 1878, essaie de le claquemurer enfin au nom de la santé, de la réputation, de la dignité… mais qui ne parvient pas à l’empêcher de s’échapper encore. Il sera deux fois verbalisé au bois de Boulogne pour outrage à la pudeur !
Au XIXe siècle, beaucoup d’écrivains, Hugo, mais aussi Lamartine, Chateaubriand et d’autres…, se sont engagés en politique. Hugo est à la fois un écrivain reconnu, académicien, et aussi pair de France, député, sénateur… On ne voit plus de cas de ce genre aujourd’hui. Comment expliquez-vous cette séparation des rôles ?
M. G. : Je crois que cela tient à la fois au statut de l’écrivain et à la professionnalisation de la vie politique, qui est devenue aujourd’hui un véritable métier, alors qu’elle était autrefois plus ouverte et, pour beaucoup, une affaire de « paroles ». Un écrivain populaire, autrement dit beaucoup lu, ce qui fut le cas de Hugo, de Lamartine, mais aussi plus tard de Zola ou de Barrès par exemple, était à même de tenir un rôle de médiateur — pour employer un mot d’aujourd’hui — c’est-à-dire qu’ils étaient capables de toucher à travers leurs écrits une partie de la population, tout en appartenant à l’élite, ce qui leur permettrait ce rôle de passeur entre l’opinion publique et le pouvoir. Il y a eu encore des écrivains engagés au XXe siècle, Camus, Sartre, entre autres, mais il est vrai qu’ils n’ont pas été députés, sénateurs ou membres du gouvernement… Le dernier exemple qui pourrait faire penser à Hugo et qui a prolongé ce type de double activité, c’est Malraux…
En fait, Hugo a répondu à son rêve, il a été plus que célèbre, avec même une avenue portant son nom de son vivant. Mais a-t-il eu le rôle politique qu’il souhaitait ?
M. G. : Il est vrai que, par son long séjour en exil, il a vraiment incarné l’anti-Napoléon III, et on ne peut pas exclure l’hypothèse qu’en effet, en rentrant en France en 1870, il n’ait espéré jouer un rôle politique majeur… D’ailleurs il a été accueilli à la gare du Nord avec La Marseillaise et Le Chant du départ, on récitait des poèmes des Châtiments… Mais finalement les années 1870 l’ont rejeté hors de la sphère politique, à cause de la guerre et surtout de la Commune. Car il n’était pas un révolutionnaire, c’était un réformateur radical, qui n’aimait pas la violence. Il n’était pas pour les communards, qui représentaient pour lui le désordre, qui brûlaient les Tuileries, l’Hôtel de Ville… Il souhaitait l’éradication de la misère mais par des lois. Et en même temps il n’était pas non plus du côté des Versaillais, parce que la répression était atroce, parce qu’ils avaient signé une paix de capitulation avec la Prusse. Il s’est donc retrouvé dans une situation très marginalisée entre deux camps, les uns battus — qu’il a défendus en réclamant pour eux l’amnistie —, les autres victorieux mais conservateurs, qui ne lui pardonnaient pas de critiquer leurs actes… Avec cet événement qui a dû le combler d’aise : quand il était à Bruxelles en 1871, réclamant haut et fort l’arrêt de la répression et l’amnistie, un groupe de conservateurs, ou du moins des jeunes gens hostiles à la Commune, sont venus lancer des pierres sur la façade de sa maison, en criant : « À mort, Jean Valjean ! » Quel magnifique hommage !
Il aura pour finir, fait unique dans l’histoire nationale, des funérailles grandioses, de l’Arc de Triomphe au Panthéon, rouvert pour l’occasion. Après Victor Hugo, au fond, tout le monde se sent petit.