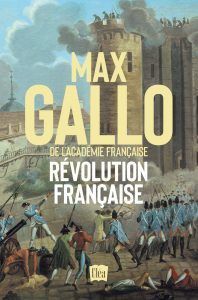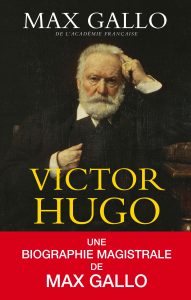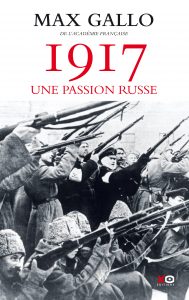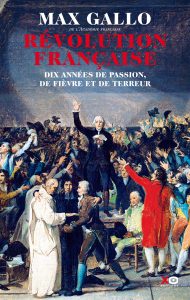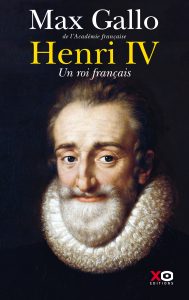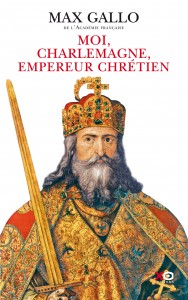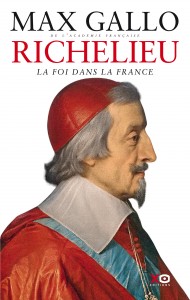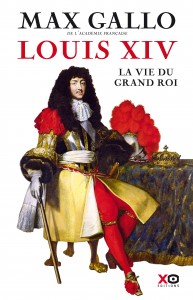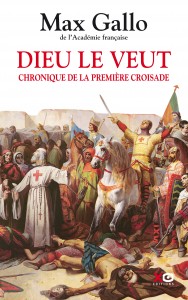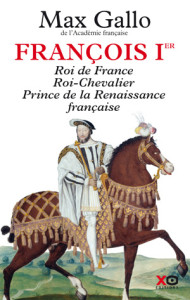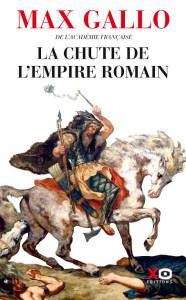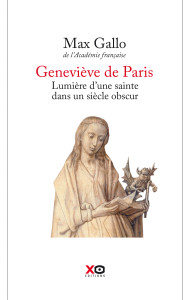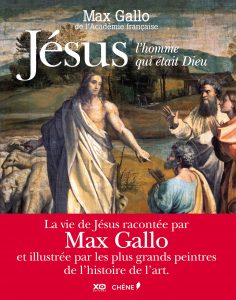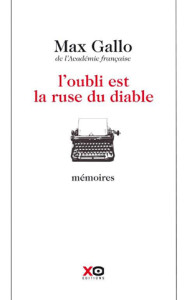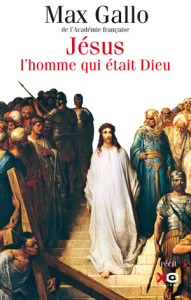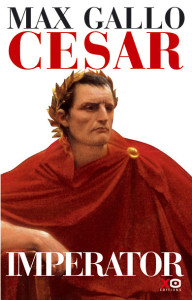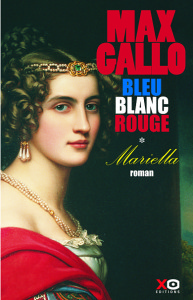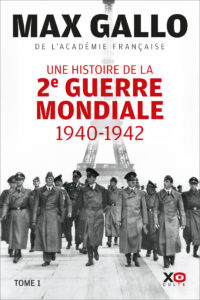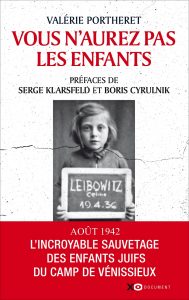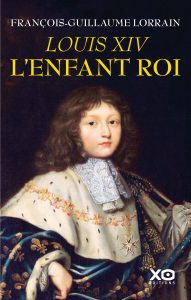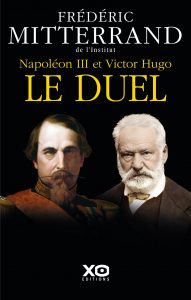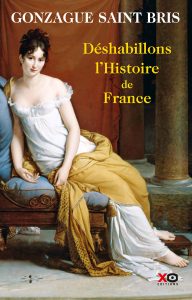Ces deux années, 1914 et 1918, sont comme les piles d’un pont entre lesquelles s’étend la durée de la guerre. Bien entendu, je raconte, année après année, les événements qui se sont passés en 1915, en 1916, en 1917. Mais 1914 et 1918 présentent de très grandes similitudes. La guerre s’est en fait jouée deux fois : en 1914 et en 1918. Pourquoi ? Les Allemands sont à 60 kilomètres de Paris en 1914 ; ils le seront encore après de nouvelles offensives en 1918. En 1914, ils remportent une victoire apparente, mais la bataille de la Marne va les stopper. Le front arrête de bouger, et les tranchées symbolisent cette nouvelle manière de faire la guerre. Néanmoins, au départ, les Allemands sont profondément entrés dans le sol français. En 1918, après quatre années de guerre, voici qu’ils lancent une série de cinq grandes offensives, qui les amènent encore à 60 kilomètres de Paris. De nouveau, en 1918, on assiste à des scènes d’exode. Paris est bombardée. On a l’impression que la guerre peut se jouer comme en 1914. Mettre face à face ces deux années permet de comprendre leurs différences et de montrer leurs ressemblances. Chaque fois, le patriotisme, l’enracinement des soldats français et alliés dans leur terre, dans le sol de la nation, a permis de résister aux offensives allemandes très menaçantes, qui ont, je le répète, conduit les troupes ennemies à 60 kilomètres de Paris.
Au début de l’année 1914, on sent bien que la guerre approche. Une partie des élites dans chaque nation la souhaite même. On assiste à une véritable course à l’armement des pays européens. Comment expliquez-vous cette volonté d’armer les nations en ce début du XXe siècle ?
On ne peut expliquer simplement ce phénomène. Une des raisons est bien sûr le fait que chacun sent les antagonismes entre les systèmes d’alliance qui unissent la France et ses alliés – c’est-à-dire la Russie, l’Angleterre –, et l’Allemagne et ses alliés – l’Autriche-Hongrie et l’Italie, qui hésite entre ces deux blocs. Ces deux blocs se rapprochent dangereusement l’un de l’autre comme deux locomotives qui vont se heurter. On construit des voies ferrées, permettant aux trains militaires, en Russie, d’arriver rapidement jusqu’à la frontière. Et ces nouvelles commandes sont intéressantes pour les entreprises. On perfectionne les armements, on imagine des bateaux de plus en plus lourds, parce que ça augmente l’activité des chantiers navals. Je ne dis pas qu’il faut appliquer mécaniquement la phrase de Jaurès : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuit porte l’orage », mais il y a dans cette course à l’armement des causes économiques. Et puis il y a aussi, surtout, le souvenir en France de la défaite de 1870, l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine par l’Allemagne. Le désir de revanche est fort. Enfin, le patriotisme – qu’on peut appeler nationalisme quand il est exacerbé – empoigne la pensée d’une partie des élites, notamment de la jeunesse estudiantine. Par exemple, à Paris, en 1914, des enquêtes montrent à quel point on ne conçoit pas la guerre comme un massacre, mais comme un sport. Les gens interrogés sur le sujet répondent : « Oui, la boxe est à la mode, et c’est bien cela que nous voulons. La guerre, ce sera une façon de faire de la boxe. »
Le jeu des alliances internationales est essentiel dans l’entrée en guerre, en août 1914. Les conséquences de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, le 28 juin 1914, en sont l’illustration. Peut-on imaginer que, sans ces alliances, la guerre aurait pu être évitée ?
Je ne suis pas de ceux qui reconstruisent les choses comme elles ne se sont pas passées. Disons que le système des alliances a entraîné, comme un engrenage, à partir de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand le 28 juin 1914, les nations dans la guerre, et que celle-ci n’est devenue mondiale que parce que les grandes nations se heurtaient. Ces nations étaient des puissances impériales, coloniales, et cette dimension mondiale des grandes puissances comme l’Angleterre, la France ou l’Allemagne a eu comme conséquence la généralisation immédiate de la guerre.
En France, les députés socialistes, qu’on peut souvent qualifier de pacifistes, œuvrent contre l’entrée en guerre. En tête : Jaurès, assassiné la veille de la mobilisation générale française. Son meurtre a-t-il eu un impact sur l’entrée en guerre ?
Non. En revanche, son enterrement a donné lieu à une manifestation d’unanimité nationale, réunissant le président de la République et ses adversaires. Mais vous avez raison de citer Jaurès, la haine qu’il a suscitée à partir de 1913 est caractéristique. On le qualifiait d’agent allemand, parce qu’il était hostile à la prolongation du service militaire – il était opposé à la loi des Trois Ans. Son assassinat est le produit de cette haine distillée par un certain nombre de ses adversaires, qui avaient parfois été ses amis – je pense notamment à Charles Péguy. Une poétesse de l’époque a qualifié Jaurès de « premier mort tombé en avant des armées ». Mais sa mort n’a pas provoqué la guerre, et son assassinat a été quasiment oublié pendant toute la période. À tel point qu’en 1919 l’assassin de Jaurès Raoul Villain – qui est resté en prison jusqu’à son procès – a été acquitté, et que la famille de Jaurès a été condamnée à payer les frais de justice – ce qui a révolté, déclenché des protestations et des manifestations.
Dans votre ouvrage, vous rapportez la correspondance entre le tsar Nicolas II et le kaiser Guillaume II. On comprend rapidement en vous lisant qu’ils ont tenté d’empêcher la guerre générale…
C’est vrai. Mais cela ne l’est pas seulement de Nicolas II et de Guillaume II. Personne n’imagine réellement ni ne souhaite de guerre mondiale. On imagine une guerre locale. L’Autriche-Hongrie veut faire payer la Serbie pour l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, en termes de territoires, de dépendance. Mais les chefs d’État pensent pouvoir cantonner la guerre dans une région. Or elle va leur échapper, pour plusieurs raisons. D’abord, les mécanismes de la mobilisation se mettent en route, la peur de l’autre est palpable, tout comme la certitude que, si on perd du temps, si on n’entre pas aussi vite que les autres dans la mécanique de la préparation de la guerre et de son déclenchement, on sera battus, on ne pourra faire face. C’est pourquoi la responsabilité des Russes est très importante. La Russie était un État autocratique qui avait connu une secousse révolutionnaire en 1905, et, certains, diplomates, ministres des Affaires étrangères, généraux, imaginaient combattre l’idée révolutionnaire, les périls intérieurs de la Russie en exacerbant le nationalisme, en entrant dans cette guerre, en soutenant les Serbes. Ainsi, le mécanisme à l’œuvre ici dépasse les intentions de la plupart des chefs d’État. Ils ne souhaitent pas la guerre générale, mais ils en prennent le risque.
Il y a une certaine naïveté de l’opinion publique qui pense à l’époque que la guerre sera courte. Les hommes mobilisés le 2 août 1914 partent confiants…
Le terme « confiants » est peut-être excessif. Il est vrai que le 2 août 1914, il n’y a pas de déserteurs, ou très peu. Les gens se rendent à la guerre parce que le patriotisme est très présent dans les consciences des paysans français, des ouvriers français, des citoyens français, des cadres intellectuels. Prenons par exemple le cas des élèves des grandes écoles, que ce soit Saint-Cyr, mais aussi l’École normale supérieure : tout le monde part. Mais pas la fleur au fusil. Il n’y a pas d’enthousiasme, contrairement à ce qu’on a prétendu. Celui-ci ne touche que de minces parties de la population française. Certains occupent les boulevards, crient « Vive la France ! », « À Berlin ! À Berlin ! », mais en réalité on accepte. On subit. On va faire son devoir. Et on imagine, c’est là qu’on peut utiliser le mot « confiant », que la guerre va être courte et qu’on sera peut-être de retour avant la fin de l’été ou à l’automne. En tout cas, que la guerre n’ira pas au-delà de l’année 1914. C’est évidemment une illusion. On ne mesure pas le potentiel d’énergie que va libérer la guerre. Énergie agressive, énergie idéologique, énergie aussi parce qu’on va perfectionner les armements. Et la guerre va durer jusqu’au 11 novembre 1918.
Plus les jours avancent, plus l’horreur de la guerre est violente. Une certaine désillusion apparaît chez les écrivains, dans la presse, dans l’opinion publique. Chacun prend conscience que le nombre de morts au combat devient de plus en plus impressionnant, avant même la fin de l’année 1914. De plus, Paris est menacée, la guerre s’installe et on commence à craindre qu’elle soit longue. Comment s’est opéré ce changement ?
Ce changement s’est opéré lentement. La presse a joué son rôle de transformation de la réalité. Elle a annoncé plusieurs fois que les cosaques, alliés des Français, étaient à deux semaines de Berlin. On pouvait lire : « Les Boches sont tellement affamés qu’il suffit pour les capturer de mettre une tartine avec de la confiture et d’attendre, ils se précipitent pour attraper cette tartine. » L’image est caricaturale, mais elle a été reprise par la presse et des gens y ont cru. On a l’impression que peu à peu on mesure ce qu’est la guerre, l’importance des pertes, le nombre de blessés, ce que racontent les permissionnaires, les blessés, les amputés notamment. Devant cette prise de conscience de la population, des généraux, poussés eux-mêmes par le personnel politique, craignent que l’union sacrée, qui s’est constituée en 1914, ne se brise. Pour éviter cela, il faut des offensives, percer le front adverse, mener des assauts. Or rien ne résiste au feu : de nouvelles armes, des canons lourds qui n’existaient pas, des mitrailleuses, des lance-mines sont utilisés, même les gaz asphyxiants à partir de 1915… Bref, cette débauche de moyens matériels rend toujours impuissante l’offensive à percer le front adverse.
Vous terminez votre ouvrage sur l’idée que l’année 1914 a été « décisive pour l’avenir du monde », et que la guerre ouverte en 1914 ne trouvera son achèvement qu’en 1991, avec la guerre des Balkans. Peut-on tirer des enseignements, cent ans plus tard, du déroulement de cette guerre ?
La guerre, c’est la violence, la mort, les blessures, les destructions. La guerre enfante la guerre. La Deuxième Guerre mondiale est le produit, l’enfant monstrueux de la Première. Les chefs d’État, Hitler, Mussolini, Churchill, de Gaulle, qu’ils soient du bon ou du mauvais côté, ont eu l’expérience personnelle de la guerre de 1914-1918. Ils entrent dans le XXe siècle avec ces souvenirs de guerre. Il est donc facile de montrer que la Deuxième Guerre mondiale, sans compter l’idée de revanche, de patriotisme qu’elle porte, est le produit de la Première, et que, en fait, c’est bien le destin du monde qui s’est joué en 1914, car les choix faits en 1914 – la guerre, ses violences – ont évidemment orienté la politique mondiale jusqu’en 1991, jusqu’à la guerre des Balkans, jusqu’à la fin de l’union des Républiques socialistes soviétiques qui avait été créée précisément en 1917 comme le fruit révolutionnaire de la Première Guerre mondiale. Par ailleurs, le moyen qui a été trouvé pour bloquer l’engrenage de la généralisation des conflits à l’origine de la Première Guerre mondiale est la création de l’Organisation des nations unies (ONU), création dans le droit fil de la proposition faite en 1917-1918 par le président américain Wilson, la Société des nations (SDN). C’est un système juridique international qui est mis en place, avec la création du Conseil de sécurité, au sein duquel les grandes puissances ont un droit de véto afin d’éviter que l’une d’entre elles ne déclenche un conflit plus vaste. ONU, Conseil de sécurité sont le produit de la SDN, elle-même née de la Première Guerre mondiale.