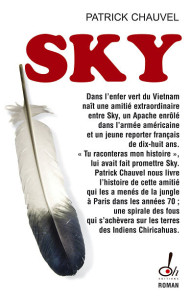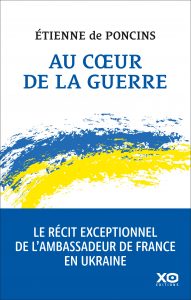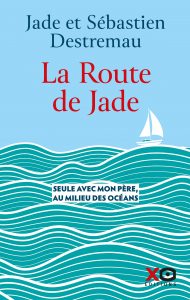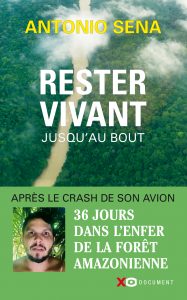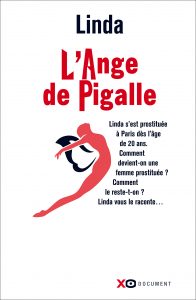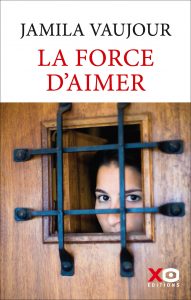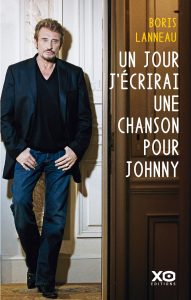J’ai baigné dans un milieu d’écrivains, mon père, Jean-François Chauvel ou Pierre Schoendoerffer… Dès l’âge de 9-10 ans, j’ai commencé à écrire des romans avec des dessins. Ensuite lorsque j’ai démarré la photo, je me suis mis à écrire des légendes. Pour m’amuser, au fil des reportages je racontais une histoire qui n’était pas forcément reprise par les journaux, mais ils s’en servaient de base.
Les premiers textes qui m’ont servi pour le livre datent de 1978, au retour du Liban. Une sorte d’urgence. J’ai écrit l’histoire de ma captivité à Beyrouth dans le vol Beyrouth-Paris, je dévorais du papier en emmerdant l’hôtesse. Après la blessure de Panama en 1991, je me suis dit que j’allais écrire ce que j’avais ressenti. Des Américains m’avaient demandé de faire un papier, un long papier sur ce qui s’était passé. Et puis après je me suis dit que j’allais écrire un jour l’histoire des journalistes et aussi des anonymes de la guerre.
Par moments quand j’écrivais le livre il y avait des souvenirs forts qui ressortaient. Je me réveillais la nuit, alors que ça ne m’était jamais arrivé avant, parce que je replongeais dans ces souvenirs que j’avais enfouis au plus profond de moi. Je me suis aperçu très vite qu’il y avait une photo à chaque histoire. J’ai repensé aux photos, je n’ai même pas eu besoin de les regarder, il suffisait d’y repenser. Et puis je retrouvais mes notes. Se raconter soi, c’était assez gênant. Ce n’est pas le réflexe que j’ai développé pendant toutes ces années, c’était de raconter les autres. Mais à travers soi, on raconte aussi les autres.
Après ce livre, avez-vous encore envie de repartir ?
Je suis passé au documentaire. Et le soir, à l’hôtel, je pense au film, je pense aux plans que je vais faire le lendemain, à ce qui me manque. Je ne suis plus dans l’instant immédiat. Ce qui est nouveau aussi c’est que j’ai le virus de l’écriture. C’est un plaisir. J’ai envie d’écrire une ou deux pages par jour. C’est vraiment une mutation.
J’ai toujours un appareil photo avec moi, la photo c’est un réflexe. Mais ce n’est pas pareil. L’écriture c’est un plus, ça accompagne la photo. La photo accroche le regard, fait qu’à ce moment-là le lecteur veut en savoir plus et donc il lit. Mais depuis quelques années, les états-majors ont pris en compte l’image et les dégâts ou les effets positifs que ça peut avoir et là il faut faire attention sur le terrain. L’image que tu vas faire est vraie, mais pourquoi on t’a laissé la faire ?
Avez-vous pris conscience de certaines choses en écrivant ce livre ?
Oui, par exemple quand je me suis mis à raconter Israël, j’ai pu retrouver quelques émotions et la manière dont je m’étais conduit à l’époque. Je me suis rendu compte que c’était n’importe quoi ; mais j’avais 17-18 ans, et j’étais tout sauf journaliste, une espèce de sale môme qui court partout et qui ne comprend rien à ce qu’il voit. Et heureusement je n’ai pas continué comme ça.
Très vite, au Vietnam, à la mort d’un des prisonniers, j’ai compris la responsabilité que tu as de raconter. A ce moment-là, tu t’amuses moins, ça devient plus sérieux. Ce n’est plus une affaire entre toi et toi, c’est une affaire entre eux et toi. Et le livre m’a montré à moi mon évolution. Je me suis rendu compte à quel moment j’ai basculé. Et dans l’écriture aussi, j’ai changé au fur et à mesure du livre. Il y a une évolution, un déclic. Ne pas être élitiste.
Si tu fais des photos magnifiques, incroyables, ou tu chantes une chanson sur la Tchétchénie avec des effets d’écriture, tu vas toucher quoi comme public ? Un public d’esthètes ? Mais le rôle de la presse ce n’est pas ça ! C’est de toucher le plus grand nombre de gens. C’est populaire, la presse. Avant, il y avait les chansons de geste. En Afrique, tu as le feu, avec les sages qui racontent. Ils parlent le langage des gens. Ce métier, c’est ça. C’est rapporter une histoire, comme un enfant quand il a vu quelque chose en rentrant de l’école, il est journaliste quand il rentre chez lui, et que le soir il décrit ce qui s’est passé dans l’après-midi à l’école, que son copain s’est ouvert le genou.
C’est ça le journalisme, c’est raconter, rapporter une histoire.
Quand vous mettez tout ça bout à bout, on ne peut pas s’empêcher de se dire que la mort n’a pas voulu de vous.
C’est des formules. J’ai eu de la chance. Tu prends des risques sans doute. Mais tu les prends toujours pour une raison précise. Quand il y a une photo à faire, ou des gens à aller voir de l’autre côté de la rue parce que ce sont des gens importants, qui vont te faire comprendre ce qui se passe, tu ne les prends jamais gratuitement. Au début, un peu, parce que tu veux voir si tu es courageux. Après tu mesures tes risques, mais quand il faut les prendre tu es prêt à les prendre même si c’est quitte ou double. Parce que tu es pris par ton histoire et ton envie de la raconter de la meilleure manière qui soit. Et après, si tu n’as pas de chance, tu fais autre chose.
Il y a des gens plus structurés, plus cloisonnés que d’autres, c’est ceux-là qui peuvent faire notre métier. C’est une chance de fonctionner comme ça. De cloisonner tout le temps.
Et il y a des gens qui ont une telle imagination que dès qu’ils sont en Tchétchénie ils s’imaginent cul-de-jatte, morts, brûlés vifs. Ça n’enlève rien à la qualité de la personne, d’avoir peur ou d’avoir trop d’imagination. Ça lui enlève la capacité de faire des reportages, c’est clair. Mais ça reste quelqu’un de formidable.
Tu ne peux pas juger quelqu’un qui a peur. C’est normal d’avoir peur, le problème c’est de savoir ce que tu fais de ta peur. Est-ce que tu la contrôles, est-ce que tu cloisonnes, ce qui te permet de travailler librement. La peur, elle est toujours là, elle est sourde, mais tu apprends à la connaître, à la maîtriser et tu finis par croire que tu n’as plus peur. En tout cas, tu n’y penses plus. De temps en temps, elle se rappelle à toi avec une balle qui te passe au ras des fesses et là c’est un petit message. Et pendant une journée tu ne sors plus de l’hôtel, tu digères le message. Les Américains m’avaient dit ça après Panama, « Strong message », un message de Dieu, « arrête ». Alors tu as des gens qui arrêtent après une blessure.
Moi, on m’a toujours appris que quand tu tombais de cheval il fallait remonter tout de suite, sinon tu ne montais plus jamais à cheval. Comme je n’avais pas l’intention d’arrêter, le mieux c’est de repartir tout de suite dès que tu es en forme pour chasser ça, chasser ce souvenir là par d’autres souvenirs ; c’est une espèce de fuite en avant.
Mais en même temps, un matin tu te réveilles, et on te dit que tu es un photographe professionnel et on a besoin de toi là, et là, et tu es pris dans le cycle. Souvent on nous parle d’adrénaline, je crois que c’est un terme beaucoup trop fort. Quand tu es sur place, dans le truc immédiat, que tu rentres le soir et que tu t’es fait peur, c’est vrai qu’il y a une espèce d’excitation, mais à minuit c’est fini. Le mec qui te raconte qu’il faut qu’il reparte parce qu’il a l’adrénaline… pour moi, personnellement, c’est pas ça. Je ne m’emmerde pas à Paris. Je vais voir des films qui ne traitent pas de la guerre. J’ai des copains qui sont architectes, éditeurs. Leur histoire m’intéresse autant que les guerres.
Est-ce que vous avez une volonté de transmission, il faut qu’il y ait une relève ?
Ce livre, c’est un peu ça aussi. C’est comme dans le film que j’ai réalisé Rapporteurs de Guerre. C’est pour ça qu’il a le même titre. Mais c’est une responsabilité face aux jeunes photographes. Qu’ils ne fassent pas n’importe quoi parce qu’ils l’ont lu dans le livre. C’est la fameuse phrase que j’avais dite à un copain, qui n’est pas de moi : « Don’t do what I wouldn’t do », « ne fais pas ce que je ne ferais pas ». Le mec a éclaté de rire nerveusement. J’étais avec lui à Ramala, je l’ai retenu par le col de la chemise, parce que étant avec moi il voulait montrer qu’il pouvait aller plus loin, il se serait fait tuer. Je lui ai dit « attends, ne te fais pas tuer tout de suite, ça ne sert à rien ». Il a appris plein de choses dans la retenue, et en Irak tous les confrères m’ont dit qu’il s’était vachement bien conduit, très calme, et il a fait de très belles photos.
Je pense que les types qui sont bons sont assez responsables, et plutôt gentils avec la jeune génération qui arrive parce que c’est un métier difficile et dangereux. Tu racontes des histoires, tu donnes l’envie, tu maintiens l’envie et ensuite tu leur donnes des clés, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et l’instinct se développe au fur et à mesure. C’est un beau métier.
C’est ça que j’essaie de montrer dans ce livre, que c’est un beau métier, un métier responsable, qui peut compter, on a encore l’illusion que ça peut changer les choses. Je ne veux plus jamais entendre, on ne savait pas. Les gens ont tous les moyens de savoir à leur disposition. Que ce soit par la télé, les journaux, la presse écrite, la radio, les photos.