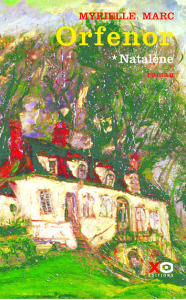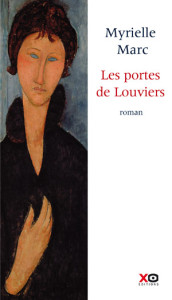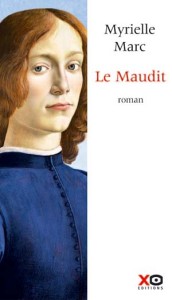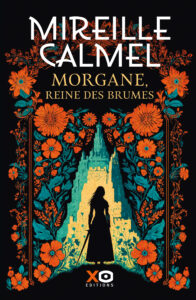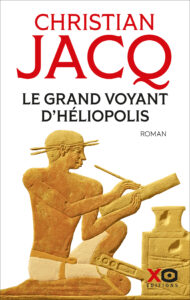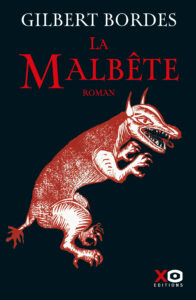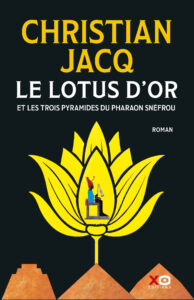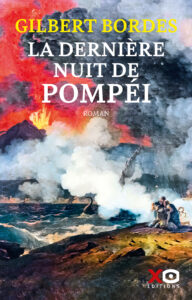Quel est votre souvenir de lecture le plus marquant ?
M. M. : La première : Les Misérables. Petite, je voyais ces trois gros volumes sur une étagère, les seuls livres qu’on avait à la maison. Donc dès que j’ai su lire j’ai pris le premier volume et j’ai commencé, sans rien comprendre parce que le début des Misérables à six ou sept ans… Mais c’était pour le plaisir de lire, d’exercer un talent. Je me souviens de mon émerveillement quand j’ai vu de tout ce fatras sortir un personnage et c’était monseigneur Myriel ! C’est pour ça que quand j’ai changé de nom j’ai choisi Myrielle. Ce personnage était vivant, aussi vivant que ceux qui m’entouraient et pourtant il sortait de signes. Je ne m’y attendais pas du tout. Il m’a aussi beaucoup surprise parce qu’il mentait. Manifestement c’était un menteur, quand il disait avoir donné des chandeliers à Jean Valjean, et pourtant il me paraissait grandiose. Je retournais en arrière dans le livre pour voir s’il les avait donnés, non il ne les avait pas donnés, alors je repartais vers l’avant, il disait bien qu’il les avait donnés, donc c’était un menteur ! Ça a été ma première ambiguïté morale.
Comment la maladie que vous appelez « absence » s’est-elle annoncée ?
M. M. : En quelques mois, à 15 ans. Les choses ont commencé à se brouiller très sérieusement dans ma tête, et je suis entrée dans une « absence à moi-même » qui n’a jamais reçu d’explication médicale satisfaisante. C’était peut-être seulement une crise d’adolescence particulièrement violente. Ma mère dit que je suis devenue bizarre, j’écartais les gens, je ne voulais pas qu’on s’approche trop près de moi. Il paraît que si on me regardait trop fixement, je me cachais les yeux. Et puis ça a empiré… on l’a convoquée au collège pour lui dire qu’on ne pouvait plus me garder, je n’étais pas bien, j’étais malade.
Et donc elle vous a gardée à la maison ?
M. M. : Oui, j’ai vu plusieurs médecins, dont l’un voulait me faire hospitaliser immédiatement, parce qu’il pensait à de la schizophrénie. Mais celui qui m’avait suivie toute mon enfance a dit à ma mère qu’il ne pouvait pas y croire, que j’étais tout le contraire d’un tempérament schizoïde parce que j’étais très costaud, très spontanée, je me mettais en colère, j’étais espiègle et active. Et heureusement elle l’a écouté. Donc elle m’a laissé faire. Je me suis cloîtrée dans ma chambre pendant deux ans. Je n’ai presque aucun souvenir de ces deux années-là. Quelques flashs. J’ai l’impression que ma vie à moi commence après.
C’est alors que vous avez changé de nom ?
M. M. : Oui, juste après. Et ça a été salvateur : j’étais vraiment quelqu’un d’autre, j’abandonnais ma vieille peau comme un lézard qui mue. J’ai choisi « Myrielle » à cause de monseigneur Myriel, qui avait été mon premier personnage littéraire. Et j’ai cru de bonne foi choisir « Marc » à cause d’un personnage que j’avais créé. Je pense maintenant que cela se rattachait plutôt à mon père, dont le prénom était aussi Marc. J’ai déployé une obstination sans pareille pour imposer cette nouvelle identité autour de moi. L’essentiel était de ne plus porter l’ancien nom, qui était très maléfique. J’avais vraiment l’impression d’un danger ! Je pense que ça a été un réflexe de survie : telle que j’étais, qui j’étais, j’allais droit dans le mur. Il fallait recommencer à zéro si je voulais survivre. Et maintenant quand je pense à cette petite fille d’autrefois, beaucoup plus gaie que moi, beaucoup plus sociable, j’ai du mal à faire le lien entre nous.
Et vous êtes retournée à l’école après votre maladie ? Vous étiez plus âgée que les autres.
M. M. : J’avais du retard, mais au lycée il y avait tous les âges, ce n’était pas gênant. Et d’ailleurs j’ai redoublé plusieurs fois, dans ce nouveau parcours. Je n’étais pas très nette encore, je ne pouvais pas sortir sans porter une bande Velpeau, autour du genou ou du poignet… Je ne sais pas pourquoi, ça me rassurait. Et puis j’avais un petit sphinx en bronze que je serrais toujours dans ma main. Ensuite ça s’est tassé… J’ai eu mon bac à 23 ans et je suis devenue instit à la rentrée suivante.
Vous gardez de bons souvenirs de vos années d’institutrice ?
M. M. : Oui, je m’entendais bien avec les enfants, j’avais l’impression de ne pas seulement avoir des connaissances à passer mais d’être encore une éducatrice, comme le sont les instits par rapport aux profs. Ils me parlaient de leurs problèmes, j’essayais d’aider… J’ai été contente jusqu’à mon dernier jour de classe, mais après je n’ai pas regretté : je n’ai pas de nostalgie, les maisons, les gens, les cycles de la vie, ça passe… beaucoup de reconnaissance et pas de regrets.
Quand avez-vous écrit Orfenor ?
M. M. : La première fois entre 18 et 20 ans, un peu après ma guérison. Quand j’ai repris pied, j’avais 17 ans et demi et c’est là que j’ai écrit, en une semaine, un livre que j’ai appelé le Maudit de Varielles. Maintenant je comprends que je parais ainsi au plus pressé : me recréer un père et une loi. Puis je me suis lancée dans Orfenor, qui avait lui aussi une intention thérapeutique dont je suis maintenant consciente. Il s’agissait, je crois, d’explorer ce qui m’attendait, la société, le rapport au corps, la sexualité, la famille, les choix à faire… la place de l’amour dans une vie… et surtout la « musique » de Tristan et ce qu’il en ferait, pour savoir ce que je pourrais faire, moi, de la force qui me poussait à écrire. J’ai écrit l’histoire d’Orfenor, des heures chaque jour, pendant plus de deux ans. Ça se présentait à l’époque comme un énorme tas de feuilles volantes, carnets, cahiers, et couvrait trois générations. Ça n’avait pas vraiment de titre, parce que dans mon esprit ce n’était pas un « vrai » livre, fait pour être lu. C’était, comme le Maudit, « un livre pour moi » : le tiroir de mon bureau qui les contenait tous les deux portait cette étiquette. Je pense que si j’avais trouvé dans une bibliothèque un livre parlant de tout ça d’une façon qui puisse me satisfaire, je n’aurais pas écrit Orfenor. Ce n’était pas du tout une démarche littéraire. Je m’étais guérie toute seule avec le Maudit, et avec Orfenor je m’enseignais toute seule.
Et où aviez-vous trouvé tous ces gens si différents, les bohémiens, les bourgeois, les « aristos » ?
M. M. : Je ne sais absolument pas d’où me vient Orfenor. Maintenant que je suis une vieille dame, je connais toutes sortes de gens. J’ai rencontré des bourgeois, des aristos, des marginaux, et même des bohémiens. Mais à l’époque c’était loin d’être le cas. À part le milieu populaire dans lequel je vivais, je ne connaissais rien du monde. Tout ce que je savais, je l’avais appris dans les livres. J’avais lu tant de choses que j’avais forcément lu des histoires de bohémiens, mais lesquelles ? Je savais d’avance, je savais me mettre dans l’état d’esprit qu’on trouve chez les bohémiens ou les bourgeois. La seule chose sûre, c’est combien peu il me faut pour créer tout un monde. Un rien du tout, s’il me touche, enfante sa planète.
Toute cette perception de l’adolescence qui traverse Orfenor, vous l’aviez saisie à 18 ans ?
M. M. : Orfenor a peu changé quand je l’ai réécrit après, je n’ai fait que réparer des naïvetés, comme par exemple ce qui touchait à la sexualité, car j’étais très ignorante sur ce sujet-là quand je l’écrivais. Mais à l’époque ça ne me gênait pas du tout de parler de choses dont je ne savais pas grand-chose : la musique, la sexualité, les rites des bourgeois, la vie dans les camps de manouches… au contraire, j’explorais un monde vierge, j’y étais libre de créer, d’apprendre à travers les gens qui l’habitaient. Je vivais vraiment avec eux tous, j’étais l’un, puis l’autre, ensuite un regard extérieur, et de nouveau l’un… et j’y mettais la même curiosité, le même bon sens que si ça avait été des expériences réelles. C’était très réel pour moi.
Et plus tard vous avez repris ces feuilles volantes qu’était encore Orfenor ?
M. M. : Oui, à 35 ans, 15 ans plus tard, j’ai retravaillé ce tas de papiers. Et on ne peut pas dire que ce livre s’est enrichi de tout ce que j’apprenais en vieillissant. Au contraire : il n’a fait que se réduire au fil du temps. Une génération de personnages a sauté, la première, celle des jumelles. Je n’ai pas tapé à la machine ce que je conservais, toujours pour la même raison : pour moi, ce n’était pas un vrai livre. Mais je l’ai recopié tout entier dans une suite de gros cahiers à petits carreaux, écrits très serré. Il y en avait onze. Dix ans encore après (1991, 92) je m’y suis attelée de nouveau, avec l’intention cette fois-ci de le mettre vraiment au propre. Une autre génération a disparu dans l’aventure, la dernière. J’ai fait de ce qui restait une version reliée et je l’ai prêtée autour de moi. C’est à partir de là que j’ai pu constater qu’Orfenor faisait aux gens qui l’aimaient un drôle d’effet : il devait toucher chez eux une corde sensible, je ne sais pas laquelle. Je l’ai alors envoyé à quelques éditeurs, sans succès. Il est retourné dans son tiroir. L’année dernière enfin, presque 40 ans après avoir écrit cette histoire, je me suis décidée. Je me suis ruinée pour m’offrir les services d’une « tapeuse » professionnelle, et j’ai pu retravailler le texte sur mon ordinateur. Je l’ai envoyé chez XO, pas vraiment au hasard mais un peu quand même, parce que j’avais lu un ou deux articles sur le parcours de Bernard Fixot. Je savais qu’il voulait publier pour « les gens de la rue », et qu’il cherchait « des histoires capables de faire rêver », ce qui me semblait convenir à Orfenor.
Votre premier livre publié, Petite fille rouge avec un couteau, vous l’avez écrit à 14 ans ?
M. M. : En fait je l’avais commencé à quatorze ans, un an avant d’être malade. Cette première version n’était pas terrible, mais j’y travaillais réellement, je voulais transcrire quelque chose. Je ne me disais pas que je l’enverrais à quelqu’un ni que ça pourrait paraître, c’était une exigence de faire un récit, une démarche littéraire. J’ai repris la Petite fille après avoir écrit Orfenor. Là, je n’ai pas conservé la première version, mais j’ai recommencé avec le même esprit, jusqu’à ce que je l’envoie.
Pourquoi vous êtes-vous dit « maintenant je voudrais qu’il soit publié », à 30 ans ?
M. M. : Je crois qu’à ce moment-là j’étais instit, adulte, j’avais une maison, j’étais entrée dans une vie réelle où les actes devaient se poser et avoir des conséquences… puisque j’écrivais, puisque j’avais fini un livre, j’allais l’envoyer et il serait pris, bien sûr ! Je n’avais pas l’ombre d’un doute. Je l’ai envoyé à Gallimard, Le Seuil et Grasset, les trois seuls éditeurs que je connaissais. Grasset a refusé, Le Seuil a accepté et Gallimard a répondu que ça les intéressait mais qu’il faudrait refaire certaines choses, condenser… Alors j’ai été voir Le Seuil.
Avez-vous bien vécu la parution de cette Petite fille rouge ?
M. M. : Non, pas vraiment. J’avais voulu, recherché que cet acte ait une conséquence, mais quand il est devenu réel… je n’ai pas aimé ça. Je n’ai pas apprécié qu’on le lie à moi, j’ai toujours détesté qu’on lie l’écrivain à son livre et qu’on parle de lui, qu’on mette sa photo derrière. Le nom pourrait suffire, ce serait encore mieux de mettre un numéro, toujours le même, et de laisser les gens tranquilles, de ne pas les piéger là, pour qu’ils puissent continuer à écrire librement. Ce n’est pas un côté intéressant. Mais tout ce qui concerne le livre est très bien. J’ai reçu beaucoup de lettres pour la Petite fille rouge. J’en ai reçu une il y a quinze jours encore, d’un monsieur de 36 ans qui me parlait de son émotion d’adolescent quand il l’avait lu….
Comment organisez-vous vos journées ?
M. M. : Je me lève à 5 heures, à 5 heures 5 avec un bol de café chaud je suis devant mon bureau, et là j’écris, en général ça dure à peu près deux heures, ce sont les meilleures heures d’écriture, c’est là que je crée des choses vraiment, que je sens que c’est net dans ma tête. Après je prends un autre petit déjeuner, je traînasse un peu, je réécris. Le matin c’est l’écriture en fait, je réécris tout en faisant quelques petites choses à moi, il y a le courrier, je passe quelquefois sur Internet, je vais dans le jardin, je vais marcher si la lumière est belle (je suis tout près de la Loire). J’écris à peu près jusqu’au déjeuner et ensuite je sors, je marche, j’écris encore je crois, et puis vers le soir commence ma vie active, je vais voir des gens ou des gens viennent me voir.
Et quand vous partez en vacances ? Vous allez sur les campings, c’est ça ?
M. M. : Oui j’attelle à ma voiture une toute petite caravane hors d’âge que j’appelle mon « champignon » et hop, en route. N’importe où. Mais pas très loin ! Je m’arrête chez des amis ou dans des campings sur la côte, face à la mer. J’oriente mon champignon pour voir la mer quand j’écris et là… le roi n’est pas mon cousin ! Toute seule dans cet espace de deux mètres sur trois, avec une grande table qui s’abat et dont je rapproche les deux banquettes pour dormir. Le grand lit occupe les deux tiers du « champignon », à l’avant il y a un petit évier, un gaz que j’ai enlevé parce que je ne mange pas là, et puis des étagères. Pour le café j’ai un petit butagaz, un réchaud qui me sert aussi de radiateur l’hiver, en retournant un pot en terre cuite dessus. Sinon je ne suis pas vraiment une grande voyageuse, j’ai un bout de carte ouest, je descends de Nantes aux Landes et un peu vers l’intérieur des terres.
Vous donnez l’impression de vivre simplement ?
M. M. : C’est vrai que je n’aime pas dépenser, j’ai horreur des magasins, je n’aime pas les choses chères. Si j’ai besoin de quelque chose je vais d’abord voir chez Emmaüs, les meubles c’est évident mais les habits aussi, les draps, les rideaux et si je ne trouve pas, je vais chez des soldeurs, sur les marchés. Il est rare que j’entre dans un vrai magasin pour acheter. Quand quelque chose se présente je me demande toujours « Est-ce que j’en ai vraiment besoin ? Est-ce que j’en ai vraiment envie ? » et neuf fois sur dix la réponse est non. Si j’en ai ou envie ou besoin, ou les deux, je l’achète. Et je peux même l’acheter cher si j’ai assez.
Vous dites qu’Internet vous a été utile ?
M. M. : Oui, j’y ai appris des tas de choses, et je me suis un peu ouverte au monde, moi qui sors si peu. Sur des forums de généalogie et de littérature, j’ai rencontré des gens qui m’ont plu, qui auraient été mes amis si je les avais croisés dans la rue ou dans un café. Ça ne tient pas une énorme place dans ma vie, quand je ne suis pas chez moi je n’y pense pas, quand je pars en « champignon » je n’y pense plus du tout, mais quand j’y suis, j’aime bien.
Vous avez dit que vous aviez fait un cheminement vers le renoncement et l’acceptation de la mort ?
M. M. : Ça a été la deuxième chose à faire dans ma vie. Il y avait l’écriture qui ne posait pas de questions, qui était essentielle, j’étais là pour ça, et après, oui il y avait cette espèce de renoncement, de distance à prendre avec le monde, les gens, une solitude à accepter… et la mort, oui. C’était une chose très importante, et qui m’a définie. Acceptation de la mort, la mienne, celle de mes proches, le passage du temps, le fait qu’on est si peu de chose, que les livres eux-mêmes n’ont pas vraiment d’importance etc.
Et le plus important dans votre vie a donc été l’écriture ?
M. M. : L’écriture c’est indéracinable, je ne sais faire que ça… même si je ne crois plus tellement ce que je croyais autrefois, que l’art, la musique, les livres, c’est une des façons de parler de l’histoire du vent et de la déchirure du ciel, celle d’Orfenor justement. Même si je n’y crois pas je continuerai parce que je n’ai pas le choix. Je n’ai jamais pu m’empêcher d’écrire, je n’en ai pas eu envie et même si j’en avais eu envie je n’aurais pas pu.