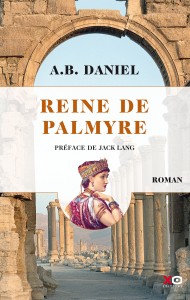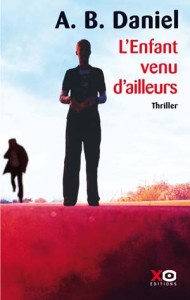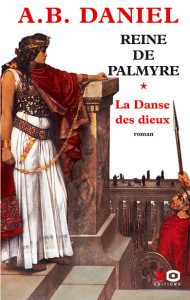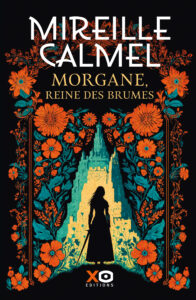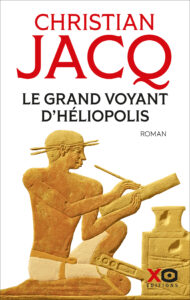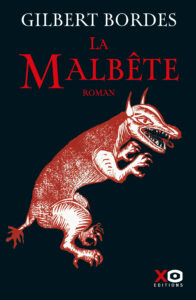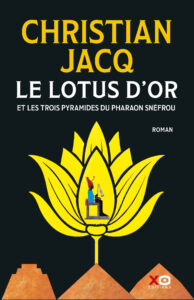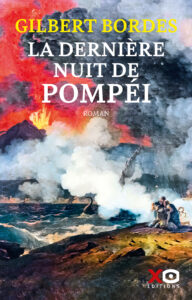Mon bonheur est d’écrire des romans qui s’inscrivent dans la belle tradition du roman populaire français. Cela peut se faire aussi bien en revivant des grands moments historiques qu’en affrontant les drames mythiques de notre histoire sociale. C’est que j’essaie accomplir avec Les Roses noires. La catastrophe de Courrières fut, au début du siècle — ça l’est encore dans Nord— un fabuleux et terrible moment de grandeur humaine qui marqua l’imaginaire collectif bien au-delà de la France.
L’héroïsme, la souffrance, la solidarité et l’espoir qui s’y déploient valent bien ceux des grandes batailles. C’est précisément le rôle du roman populaire de faire revivre ces épopées qui n’appartiennent pas à la « grande Histoire » comme on disait autrefois, mais pourtant marquent au fer rouge notre mémoire sociale.
Personnellement, ces situations où l’homme peut montrer ce qu’il vaut me fascinent. Elles sont pour moi intensément romanesques. Nous avons là tous les ingrédients : un univers clos où résonne le rôle de chacun, le chaos de la catastrophe, la nécessité de la solidarité, le vertige de l’effroi et la souffrance où chacun se révèle… Je ne peux m’empêcher de vivre ces instants comme une sorte de leçon de vie que nous donnent nos « anciens », et que je trouve terriblement valide, nécessaire même, aujourd’hui. Dans ce domaine, Robert Merle est un de mes maîtres.
Comment avez-vous découvert cette histoire ?
Par hasard, dans ma voiture, il y a six ou sept ans en écoutant la radio. J’ignorais tout. L’ampleur de la catastrophe m’a sidéré : plus de 1000 morts, une centaine de kilomètres de galerie ravagées par le feu en une poignée de secondes, l’incroyable survie des treize « rescapés », la grève. J’ai su immédiatement que je voulais en faire un roman. Qu’il le fallait même. Mais le temps a passé vite. J’étais pris par d’autres histoires. Et je n’ai, même pour mes proches, pas un grand sens des anniversaires. Je n’ai donc pas fait le lien 1906/ 2006. En mars de l’année dernière, des journaux ont évoqué la catastrophe de Courrières à l’occasion du centenaire. J’étais furieux et certain de voir sortir un roman dans les jours suivants… Mais non. J’ai aussitôt appelé Bernard Fixot. Nous avions un autre projet en route et même bien avancé. Il s’est laissé convaincre de le repousser pour que Les Roses noires puissent paraître en ce début d’année.
Diriez-vous que Les Roses noires est un roman d’aventures ? Même si on sait déjà que certains des mineurs ne vont pas s’en tirer ?
Oh certainement ! Être piégé dans un labyrinthe pendant plus de 20 jours, à la merci de la nuit, à trois cents mètres sous terre, sans lumière, ni eau, ni nourriture… Comme aventure, il est difficile de trouver mieux! Il faut puiser dans toutes ces forces humaines pour s’en sortir, croyez-moi. Le drame se transforme en un grand théâtre du courage, de la volonté, de la lâcheté, de l’amour… En outre, l’aventure n’est pas seulement « dessous » mais aussi en surface. C’est celle de l’abnégation de quelques-uns qui risquent leur vie pour sauver celles des autres. C’est celle des milliers de femmes des corons qui déployèrent une prodigieuse « solidarité spirituelle ». Abattues par l’angoisse, la solitude, elles tentèrent de faire remonter leurs hommes en refusant leur mort. Lorsque ce refus devint une folie, la rage au ventre et dans des conditions de survie épouvantable, elles soutinrent l’affrontement de la grève.
Comment avez-vous mené vos recherches ? Quelle est la part de la fiction dans votre roman ?
Il existe un musée de la mine à Courrières, proche du lieu de la catastrophe. Il concentre les archives de la catastrophe, les témoignages historiques, les documents de l’époque — les rapports d’enquêtes officielles, une presse abondante…— ainsi que le travail des historiens. Tout cela est très facile à consulter.
Les témoignages des rescapés sont nombreux et contradictoires. Pour un romancier, c’est une aubaine : on en apprend plus sur ces hommes dans leurs silences et leurs contradictions que dans leurs souvenirs. Ces mineurs sont terriblement pudiques. Même lorsque la presse les expose, ils sont loin du déballage de leurs sentiments.
Les premiers témoignages publiés furent ceux de deux survivants devenus des héros nationaux célébrés comme tels par la suite. Le journaliste qui les a retranscrits semble avoir pris beaucoup de liberté dans sa rédaction. Leurs camarades s’en sont offusqué et se sont confiés à un autre journaliste. Il a raconté leur version, passablement différente. Puis, un troisième a éprouvé le besoin de faire écrire la sienne, différente encore des précédentes. Enfin, un quatrième, un jeune mineur, patron du cheval que les réchappés ont dû tuer pour survivre, a tout réécrit… sans une seule fois évoquer son cheval ! Il n’a pas supporté sa mort — un massacre à vrai dire : comment tuer « proprement » un cheval dans l’obscurité absolue ?
D’autre part, la catastrophe a été le premier événement médiatique du XXe siècle en France. La presse se vendait alors par millions d’exemplaires. Les journalistes ont abondamment couvert le drame. Cela a joué un rôle essentiel dans l’émoi qui souleva le pays et permis de prendre conscience de la réalité du travail et des risques des mineurs, ces ouvriers-aristocrates comme ils se considéraient.
Il y eut aussi les rapports d’enquête multiples qui donnent d’autres versions, montrent la lutte entre la direction et les mineurs…
Comme toujours, ces « variantes » laissent la place à l’imagination. C’est l’espace de liberté nécessaire au roman. On joue de ces contradictions en construisant une réalité plausible, palpable. Parfois, l’émotion vécue dans la lecture romanesque devient le meilleur guide vers une vérité que la raison ne peut rendre que plus confuse.
Comment oser, en tant que romancier, se réapproprier un tel drame ?
Par inconscience, sans doute ! Je ne me suis pas rendu compte du « voyage » que j’allais faire. Lorsque l’on travaille sur des grands événements historiques, comme les conquêtes des Incas au Pérou par exemple, on se trouve en empathie avec certains personnages, mais on les « habite » avec un certain recul. Cette fois-ci, je me suis retrouvé « dessous » avec ces hommes. Cela peut paraît excessif, mais soudain, sans crier gare, je les ai sentis là, qui me jaugeaient pour ainsi dire. Ces centaines de morts pesaient sur moi avec une émotion extraordinaire que la vie, la tendresse et le rire d’autres personnages (Eliette, Rabisto, les enfants…) allégeaient et rendaient poignant.
1906, c’est très proche. Les héros dont je parle ont eu des enfants, des petits-enfants, certains sont encore vivants. Il y a là quelque chose d’émotionnellement très fort. Mais cette proximité historique fait aussi, sans doute, que l’on prend plus de précautions, c’est pourquoi j’ai changé certains noms de personnage réels afin d’être libre et de ne pas choquer inutilement.
On n’a jamais vraiment élucidé la cause de cette explosion de Courrières. On a parlé d’un feu… qu’en pense-t-on aujourd’hui ?
Il y a une certitude : contrairement à ce que les mineurs ont cru, ce n’est pas le feu dans la voie appelée Cécile qui a déclenché l’explosion mais un coup de grisou dans la voie dite Lecœuvre. Ce qui n’a jamais été élucidé, c’est ce qui a déclenché ce grisou. La mine de Courrières n’était pas reconnue comme grisouteuse. Ce gaz naturel se dégage spontanément de certaines veines. Au contact de l’air, il explose à la moindre étincelle. Quelle fut cette étincelle ? J’ai suivi dans le roman l’hypothèse qui m’a paru la plus probable.
Par contre, on connaît le mécanisme après l’explosion : ce que l’on appelle un « coup de poussière ». La flamme allumée par le grisou s’est nourrie de la poussière de charbon qui recouvrait le sol. Elle est devenue un véritable monstre de puissance.
Hélas, la défiance entre les ingénieurs et les mineurs fut aussi terrible que l’explosion. Les ingénieurs furent incapables d’entendre la sagesse des mineurs qui sentaient venir un mauvais coup. Ensuite les mineurs refusèrent d’accepter la vérité sur les causes de l’explosion et toute parole de l’encadrement devint suspecte.
Que faites-vous quand vous n’écrivez pas des grands romans d’aventure ?
Je voyage, partout, dès que je peux ! Je ramène des cuillères en bois, j’ai une passion pour les cuillères en bois et tout ce qui est en fer blanc ! Ma maison devient une sorte de musée d’art populaire ! Mais comme j’écris sous différente « casquettes », je passe plus de temps devant l’ordinateur qu’en balade !