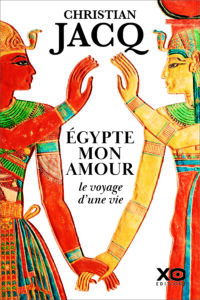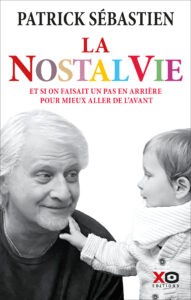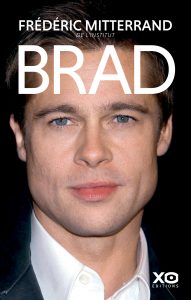Les 7 vies du Dr Kouchner
Autobiographie et mémoires Documents
Fondateur de Médecins sans Frontières puis de Médecins du Monde, militant, journaliste, gastro-entérologue à l’hôpital Cochin, scénariste d’une célèbre série, premier des french doctors, député européen, ministre, un temps dirigeant d’un pays, le Kosovo, homme de gauche dans un gouvernement de droite… il est aujourd’hui le ministre des Affaires étrangères de la France.
Qui est Bernard Kouchner ?
Né dans le monde en feu de 1940, lycéen puis étudiant il milite pour la paix en Algérie, au Viêt-nam, en Amérique latine… Dès la fin de ses études de médecine il part en mission pour la Croix-Rouge au Biafra. Nous sommes en 1968, à une époque où l’on doit soigner et se taire, où le monde entier ferme les yeux sur les guerres et les famines du tiers-monde. Mais Bernard Kouchner refuse de rester silencieux. On n’essaie même pas d’empêcher les massacres, et c’est cela qu’il trouve insupportable. Il entre dans la vie publique. Le droit d’ingérence humanitaire, celui des french doctors, est né. Bernard Kouchner va consacrer sa vie à l’imposer au monde.
Dès lors, il est de tous les combats pour les autres, à travers tous les continents, souvent au péril de sa vie. Afghanistan, Cambodge, Pérou, Tchad, Liban, Salvador, mer de Chine, Kurdistan, Rwanda, Éthiopie, Somalie… Ses aventures racontées ici sont tragiques et passionnantes, où le rire vient souvent au secours du médecin dans l’horreur.
Beaucoup aimé et beaucoup trahi, contesté souvent, excessif parfois, engagé toujours, père de quatre enfants, Julien, Camille, Antoine et Alexandre, Bernard Kouchner partage sa vie avec la journaliste Christine Ockrent. Débatteur passionné, ami fidèle, il aime aussi la rigolade, le vin rouge, les vacances en bande, la course à pied, le ski et les bateaux…
À lire le récit de Michel-Antoine Burnier, on le découvre, Bernard Kouchner a eu sept vies. Avec comme fil directeur la générosité et l’aventure.
Interview de l’auteur
Vous avez beaucoup écrit avec Bernard Kouchner, pourquoi aujourd’hui écrivez-vous sur lui ?
Michel-Antoine Burnier : Parce qu’il était passionnant et nécessaire de raconter une vie nourrie par l’aventure et qui traverse un demi-siècle dans le monde entier. Quand il n’y a personne pour l’écrire, l’action s’efface. Après tout, cet homme a vu plus de guerres que Napoléon.
Vous a-t-il été difficile de concilier l’amitié et le travail du biographe ?
M.-A. B. : Peut-on écrire l’histoire d’un proche ? Oui, mieux que l’historien qui viendra après et montera ses explications en ignorant les confidences, les doutes, les hasards, les amours, les influences, l’humour, les distances. Non, parce qu’on manque de recul. Parfois la nostalgie embellit et recompose. Mais elle donne aussi le climat de l’époque, ce qui manque à tant de livres d’histoire.
J’ai longuement interviewé près de cent personnes pour cette biographie, y compris les plus féroces ennemis de Kouchner. Ce livre est un récit et un témoignage, non seulement le mien mais celui de tous ceux, parents, amis, médecins courageux, qui m’ont parlé. Je connaissais bien Bernard. Eh bien j’ai encore découvert des épisodes qui m’ont surpris.
Depuis quand le connaissez-vous ? Pouvez-vous raconter cette rencontre ?
M.-A. B. : Nous nous sommes rencontrés pour la première fois au comité de rédaction de Clarté, journal rebelle des étudiants communistes au début des années 1960. Tous deux militants, tous deux littéraires et passionnés par le style, tous deux fascinés par la presse et les imprimeries, tous deux férocement anti-staliniens et se moquant des doctrinaires. Nous savions nous amuser et fédérer les bons compagnons. Nous adorions la parodie, ce qui fâchait les camarades trop sérieux.
Vous racontez que Bernard Kouchner avait une âme et une plume de journaliste. Pourquoi a-t-il choisi la médecine ?
M.-A. B. : Difficile à dire. Bien sûr, son père, médecin dans l’âme, a joué un rôle. Georges Kouchner était un homme des Lumières, un personnage important dans la vie de Bernard. Mais celui-ci, à quinze ans, dix-sept ans, voulait être réalisateur de cinéma. A vingt-cinq ans, il a songé devenir journaliste. Puis il a dû penser qu’on connaît mieux les hommes à travers la médecine que par la presse. Cela dit, il n’a jamais ouvert de cabinet ni posé sa plaque. Bernard Kouchner allait tous les matins à l’hôpital, l’après-midi il écrivait, militait et rêvait d’aventures…
Selon vous quelle a été la raison de son premier départ, sur sa première mission ?
M.-A. B. : Lorsqu’il part pour la première fois, c’est au Biafra en septembre 1968, un réduit assiégé, bombardé, rongé par la famine. Chez lui, c’est autant le coup de folie d’un jeune homme mécontent de l’état du monde et de sa vie qu’une formidable intuition politique. N’oubliez pas, nous sommes en 1968. Lui, à l’inverse de ses camarades, ne croit ni à l’action révolutionnaire dans la France issue de Mai ni au Printemps de Prague, c’est-à-dire la réforme du communisme. Pour Bernard, tout cela vient trop tard. Il se jette dans l’avenir, la misère du Tiers-Monde, le déséquilibre de notre planète, la lutte contre les dictatures. A partir de là, sa pensée évolue très vite : c’est bien de soigner pendant et après les guerres, ce serait mieux de les empêcher. Plus tard, il appellera cela le devoir puis le droit d’ingérence, qu’instaureront ou confirmeront près de deux cents résolutions de l’ONU et la présence de Casques bleus dans des dizaines de pays. Mais pour y parvenir, il fallut un long chemin à travers l’action humanitaire, la fondation de Médecins du monde et Médecins sans frontières, les dizaines et dizaines de missions, villes assiégées, hôpitaux sous les bombes, sauvetages d’enfants affamés, expéditions invraisemblables dans les montagnes ou les déserts… L’idée ultime, c’est d’arriver un jour à pouvoir dire : « Monsieur le dictateur, vous n’avez pas le droit d’attaquer vos voisins ou de massacrer vos populations, et nous allons vous en empêcher, y compris par la force. »
Selon vous, quel est son plus beau combat ?
M.-A. B. : J’en vois deux. D’abord le sauvetage des boat people qui, à partir de 1979, fuyaient le Viêt-nam communiste et se noyaient par dizaines de milliers en mer de Chine. Personne ne voulait les secourir et d’ailleurs la loi internationale ne le permettait guère. Eh bien partant de rien, lâché par une part de ses camarades, Kouchner est arrivé à affréter un bateau, à secouer l’opinion, à entraîner d’autres navires, et, neuf ans plus tard, à changer la loi aux Nations unies.
Deuxième combat fameux : lorsqu’en 1991, au revers d’une guerre perdue, Saddam Hussein a massacré les Kurdes et qu’un peuple entier fuyait dans les montagnes glacées, sans eau, sans nourriture, sans rien, et prêt à mourir. Là non plus, personne n’a bougé, et surtout pas les armées alliées présentes aux frontières de l’Irak. J’ai le souvenir que nous nous sommes retrouvés tous les deux à écrire une pétition comme lorsque nous avions vingt ans – solution de misère.
Quatre jours plus tard, Kouchner était parvenu à convaincre Mitterrand, à faire bouger les États-Unis, à entraîner les Britanniques… Les armées alliées ont protégé les Kurdes et les ont ramenés chez eux en faisant reculer le dictateur. Ce fut probablement le seul génocide évité du XXe siècle.
Vous êtes un de ses plus vieux amis. Comment avez-vous vécu sa nomination au ministère des Affaires étrangères ?
M.-A. B. : Comme la fin définitive de notre jeunesse si longtemps prolongée. C’est un acte d’adulte. Cela fait toujours un pincement au cœur. Mais du moment que nous pouvons encore nous amuser ensemble. Oui, c’est encore permis, même au Quai d’Orsay.
Comment décririez-vous Bernard Kouchner à quelqu’un qui ne le connaîtrait pas ?
M.-A. B. : Je ne le décrirais pas. Je dirais simplement ce qu’on m’a dit il y a quarante-quatre ans au quartier Latin : « Il faut absolument que tu rencontres Kouchner. Tu verras, il te plaira beaucoup. » Ce fut vrai, même dans nos désaccords et dans nos belles querelles.