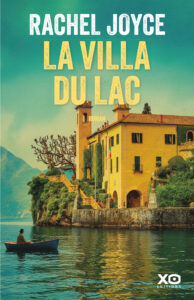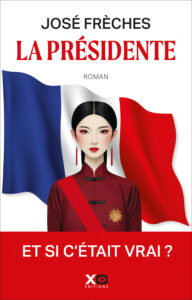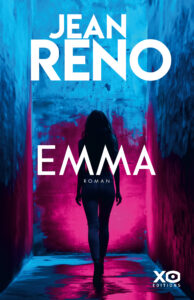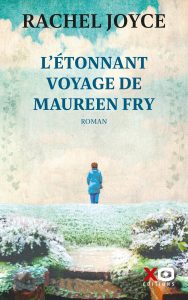Le monde dans lequel nous sommes ne me convient pas mais je le vis quand même – et malgré les secousses – avec une totale ivresse. Assez lucide pour admettre que l’univers désiré ne me sera jamais donné… je l’invente.
Loin de moi l’idée de délivrer des messages, mais il n’empêche que je voudrais une humanité plus juste. L’aventure du Prince ou le Festin des fous est totalement romanesque : le rêve n’est pas une solution, il est création et donne du moins un sentiment d’évasion.
On entre en effet dans ce roman comme dans un rêve un peu fou, la conquête d’une sorte de paradis. Comment vous est venu ce rêve ?
En cherchant ce qui ne saurait exister : l’émergence d’ailleurs désirés. Paradis est un mot dévoyé, mais il doit bien y avoir des cercles où l’on aime à vivre ensemble. C’est au cœur des conflits que l’on trouve des îlots de réflexion. Mes huit années au Sud-Est asiatique m’ont ouvert les yeux. Tous les « perdus » qui se découvraient dans une drôle de guerre au bout du monde n’étaient pas mieux que des désespérés. J’ai tenté de comprendre leurs quêtes multiples, leurs impossibles rêves. J’aime le Vietnam, j’ai été séduit par le Cambodge, j’ai trouvé Angkor bien plus remarquable que Venise, j’ai ressuscité le Siam – aujourd’hui la Thaïlande – qui abritait autrefois le royaume de Rama. Sans doute suis-je encore un Asiate récupéré par l’Occident…
Nous nous retrouvons donc dans ce royaume de Rama, pays réinventé situé entre la Thaïlande et le Cambodge… On ne peut s’empêcher d’y voir l’influence de vos débuts de journaliste en Indochine…
Je m’amuse à être né deux fois. La première, aux Pyrénées, la seconde en Asie. La folie, les perversions de la guerre, le tragique de l’expédition, les bonheurs éphémères de ceux qui allaient mourir ont accompagné mes années adolescentes. J’ai eu la chance de vivre mon métier auprès de Lucien Bodard, Graham Greene, Jean Lartéguy, Raymond Cartier, aux yeux desquels je n’étais encore qu’un « bébé ». J’ai couru dans les sentiers de l’Asie, pataugé dans les rizières, escaladé les collines, je me suis égaré dans des forêts immenses où la fréquentation des animaux, tigres et éléphants, la découverte de trésors architecturaux, m’auront donné beaucoup à rêver. Le décor de mon roman s’est peut-être imposé à ce moment-là.
Vous avez choisi quatre « mousquetaires », venus des quatre coins du monde, pour sauver ce royaume de Rama. Qui sont-ils ? Et sur quels critères ont-ils été sélectionnés ?
La seule correspondance de mes personnages avec les favoris d’Alexandre Dumas tient à l’honneur. Mon histoire se déroule dans des mondes différents, dans des lieux où l’exotisme déroule quelques fantasmes. Les mystères de l’Asie n’ont rien à voir avec les affrontements de la cour de France. Les acteurs de ce roman n’ont plus rien à perdre, ils ont raté les premiers élans de leur vie, ils tentent de se reconstruire, ils ont pour cela les qualités essentielles et d’abord la gourmandise de revivre. Ils ont été sélectionnés par des envoyés du royaume qui, partout dans le monde, se sont mis à leur recherche. On ne leur demande point autre chose que de servir une cause que l’on annonce noble et un prince qu’ils ne connaissent pas. Sans doute sont-ils les aventuriers d’une arche retrouvée. Le critère de reconnaissance est simple : on exige d’eux qu’ils plongent dans l’inconnu sans le moindre souci de récompense. Ils savent que ce qui manque le plus à notre monde boursouflé de vanités, c’est l’extravagance. Vont-ils tenir le pari de rester marginaux ?
Ils sont quatre à avoir été choisis sur une liste d’au moins cent noms : Phoebus le Béarnais, Faouzi le soufi, Sonitpur le bâtard, Golitzine l’aristo. Rassemblés dans un bar de Saigon, ils ne se sont jamais vus auparavant.
Ces nouveaux arrivants vont donc rencontrer le mystérieux Prince du royaume, mais ils sont d’abord accueillis par un homme remarquable : le baron Cambus. Parlez-nous de lui…
Avec ce baron qui pourrait être l’honnête homme des temps modernes, je passe de la réalité au virtuel, disons à l’imaginaire. Dans un précédent livre, publié il y a un quart de siècle – et réédité –, Tant qu’il y aura des îles, je racontais l’une de mes rencontres les plus extraordinaires, une aventure vécue. C’était au Cambodge. J’avais été accueilli au plus profond de la jungle par une sorte de fou qui habitait une citadelle peuplée de bêtes sauvages. Il cachait son identité, dissimulait son passé, je l’avais appelé Cambus. Il est resté, ardent, dans mes souvenirs. Le Cambus dont nous parlons ici est son petit-fils. Et celui-là, je l’ai totalement inventé, ce qui me permet de prolonger mon aventure indochinoise. Il est le gardien des secrets du royaume de Rama, l’homme lige du Prince, le conseiller le plus écouté. Sans lui, sans son obstination, il n’est pas de paix possible. Des quatre « mousquetaires », il va faire sa garde rapprochée. C’est un grand seigneur dont la seule ambition est de bâtir un monde convenable, humain, généreux. Poursuivre l’utopie ne lui est pas un luxe.
Et comment résumer le souhait, la philosophie – et donc le combat qu’entreprend cet étrange monarque, auquel les mousquetaires doivent participer ?
Le Prince est le descendant d’une monarchie millénaire. Il est d’aujourd’hui, de notre XXIe siècle, mais il obéit quand même aux plus anciennes traditions. Le protocole de cour est exigeant, le faste à la mesure du passé, mais c’est le présent qui importe. Il est le pivot de l’histoire, et le mystère qui l’entoure n’est connu que de quelques-uns. Le désespoir qu’il ne manifeste jamais lui est une raison de vivre et j’aimerais que l’on aille jusqu’au bout de ce roman pour comprendre.
Qui sont les « fous » de ce Festin ?
Ils ne sont pas différents de ceux qui, dans nos sociétés, bousculent la paix pour obtenir le pouvoir. Les sectes dévastatrices ont en Asie – et surtout dans mon roman – des ambitions démoniaques. Les personnages de mon histoire ne sont pas armés que de bons sentiments… Il faudra se méfier d’un certain Kubilaï, descendant de Gengis Khan, qui mène les bandes.
Ce roman se passe, certes, à l’autre bout de la terre, on y retrouve des éléphants, des tigres et des gibbons… et des bouffons, mais l’aventure est d’aujourd’hui. Vos personnages communiquent par portables, se déplacent en 4 x 4 ou en hélicoptère, font des séjours à Paris. Est-ce à dire que le temps ici n’existe pas ?
J’ai souhaité mêler le passé et le présent. Nous sommes, dans ce roman, en 2003. J’aurais pu dire en 2006. Et c’est exact : l’un des thèmes de mon histoire, c’est le temps ; le temps qui fuit, le temps qu’il reste, le temps de découvrir l’intime de chaque être, le temps de tenter de comprendre. C’est aussi un chant d’amour à la forêt, à l’incroyable liberté de la nature. Plus qu’aux animaux et aux humains de passage, la forêt appartient aux arbres. « Longue vie à ceux qui font respecter la loi de la jungle », disait Kipling.
Il est un autre personnage que nous n’avons pas encore évoqué et que j’aime, et qui existe véritablement : le conservateur Laure. Je l’ai connu au Cambodge, il vit aujourd’hui dans le Midi de la France. Il m’avait reçu à Angkor, dont il fut longtemps le conservateur. Il ne vivait que pour ses fouilles, où je l’accompagnais souvent. C’était chaque jour une découverte nouvelle ! Je me souviens de cette confidence : « Au Siam, ce qui ne sera jamais déniché est plus beau encore. Il y a des cités sous la terre. » J’avais aussitôt noté l’indication. L’imagination aidant, j’ai retrouvé l’une de ces immenses cités et j’ai conservé le nom de M. Laure pour ce roman.
Un mot encore, pour dire que le monarque de mon histoire, venu du fond des siècles, ce Prince est à la tête d’un empire si riche, si libre, que les alliances avec d’autres pays ne lui sont d’aucune importance. L’argent ici ne compte pas. Chaque habitant est assuré de son devenir. Le Prince de ce Festin des fous est en révolte contre son père. Un vrai chef commence toujours par désobéir.
Jorge Luis Borges vous a dit un jour : « J’écris en voyageant. » Et vous, comment écrivez-vous ?
Borges, avec lequel j’ai passé toute une semaine à Buenos Aires, auquel j’ai consacré un livre d’entretiens, était aveugle à la fin de sa vie. Mais, je l’affirme, dans nos promenades il voyait tout et dictait immédiatement ses impressions. Albert Cohen, lui, affirmait : « Moi, je pense immobile. » Marguerite Yourcenar prétendait qu’un roman « est le fruit de mille lectures ». J’ai trop écouté pour avoir une idée personnelle. On doit entrer dans son histoire comme on pénètre dans un monastère. Seul… J’écris chaque soir. Et, comme Borges, je suis encore persuadé que « le rêve est la seule création véritable ».