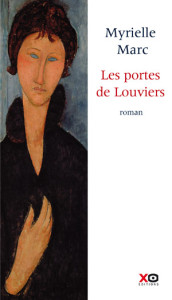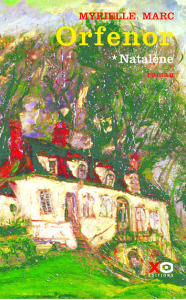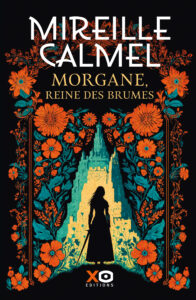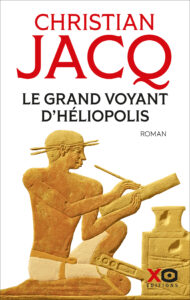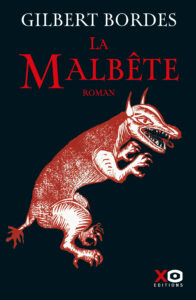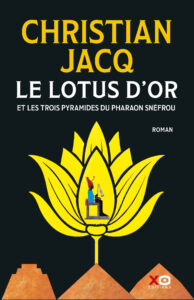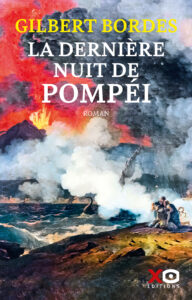Mes livres ont tous des années d’écart entre leur écriture et leur publication, parce que j’ai commencé à écrire très jeune et que l’envie de publier, l’idée même de le faire, m’est venue très tard. Sans compter qu’il n’est pas si facile de faire accepter un manuscrit une fois qu’on s’est décidé à le proposer. Ils ont donc tous fait une station plus ou moins longue dans la malle à manuscrits de ma cave, où plusieurs sont encore. Si Le Maudit détient le record, avec ses quarante-trois ans d’attente, c’est qu’il a été le premier écrit, et que pendant très longtemps je l’ai considéré comme un simple gribouillis de jeunesse. Tel qu’il était d’ailleurs, mal construit, et d’une incroyable violence, il n’aurait été accepté par personne. Je repensais parfois à lui, mais pendant les vingt premières années je n’ai jamais eu l’idée de le relire et encore moins celle de le refaire. Il était bien là où il était, dans sa malle.
Vous rappelez-vous la « naissance » du Maudit ?
Parfaitement. Je venais juste d’émerger de cette étrange maladie que j’avais eue, entre 15 et 17 ans. Amnésie, schizo, ou simplement crise d’adolescence, ça n’a jamais été éclairci. Quoi qu’il en soit je me réveillais lentement de cette « absence », avec un visage différent, plus aucun lien réel avec personne, et deux années vides derrière moi. Je n’avais pas de souvenirs de ces années perdues, et ceux de ma vie d’avant étaient eux-mêmes assez flous. Mais j’avais toujours l’envie d’écrire, comme avant. Plus qu’une envie, une exigence, une obligation : une incapacité à ne pas écrire, en fait. Ecrire, ce n’est pas tracer des mots, en tout cas pas pour moi. C’est d’abord être habité par un monde. Le créez-vous, ou est-ce lui qui s’installe en vous ? Je n’en sais rien, et ce n’est pas vraiment mon problème. Ce qui grandissait en moi, dans cette chambre de convalescente dont je n’osais pas encore sortir très longtemps, c’était l’histoire d’un autre enfermé. Condamné, coupable, exclu, maudit, monstrueux… une lande désolée, des chevaux furieux. Le Moyen-Âge, peut-être ? Ou alors un monde imaginaire. Une île, isolée elle aussi, tout le monde est seul, tout le monde est criminel, tout le monde doit payer, souffrir, tuer, tout n’est que violence et silence. Il y a des cages et des fouets. On ne tue même pas proprement : on arrache les yeux, on tranche les langues et les mains, on livre les mourants aux chiens ou aux corbeaux. Je me souviens très bien de cette première tonalité du livre. Tout existait déjà et pas un mot n’était encore écrit. C’était un monde extrêmement sombre et cruel, désespéré, sans une lueur d’espoir ou d’humanité nulle part. Et ceux qui trouvent aujourd’hui cette histoire violente font bien de n’avoir pas connu sa première version ! Le seigneur de Louvars, qui commençait à se dessiner dans le tableau, était pour son prisonnier un gardien d’une férocité sans pareille. On avait jeté ce prisonnier dans un trou creusé à même le sol de la cour, et recouvert d’une grille. Quand il en sortait il était sauvagement frappé par tous ceux qui le croisaient. L’hiver et le froid régnaient, ils semblaient éternels. Là, j’ai commencé à écrire cette histoire, sur un gros carnet. Ça ne m’a pris qu’une dizaine de jours, et j’écrivais du matin au soir, complètement hallucinée, sans rien faire d’autre. Etrange alchimie que l’écriture : j’écrivais l’horreur, la solitude, le crime, et voici que de petites lumières apparaissaient par-ci par-là. Ni contre ma volonté ni avec elle : elles brillaient, et moi je suivais. Le seigneur de Louvars avait pitié, un vieil apothicaire faisait son entrée, plein de compassion lui aussi, des fleurs naissaient sur la lande, le trou devenait une chambre, le bracelet vert n’agissait plus que de temps à autre, le Maudit savait rire, son histoire était un conte dit par une grand-mère… et surtout une intrigue se dessinait, qui permettrait peut-être l’espoir et la rédemption.
Comment une jeune fille de 17 ans peut-elle évoquer avec autant d’acuité la douleur ? Le bien et le mal ?
Ça, je ne sais pas. J’écrivais pour moi seule, à cette époque, sans même concevoir l’idée que ça pourrait être lu. Un peu comme on rêve, et qui pourrait rêver avec vous ? Je n’avais donc aucun frein, aucune réserve, rien ne pouvait filtrer ce qui m’habitait. Et l’univers de l’adolescence est extrêmement violent. C’est une dure bataille que de grandir, d’accepter le monde et ses lois. Ça l’était surtout pour moi, qui venais de renaître à neuf et devais refaire très vite tout ce long chemin.
L’avez-vous beaucoup retravaillé, au fil des années ?
Je l’ai rouvert pour la première fois plus de vingt ans après l’avoir écrit. J’avais alors une quarantaine d’années. Sa violence m’a surprise, mais j’ai senti qu’il me parlait encore, et je l’ai réécrit du début à la fin. Je n’ai rien changé à l’histoire, ni au monde de Systèle. J’ai aussi conservé le style, assez châtié, mais surtout sévère, un peu raide. Je lui ai même trouvé un nom : c’était un « style de vitrail ». Il ne m’a jamais servi que pour parler de Systèle, mais il lui convenait bien. J’ai atténué la cruauté de certaines scènes de fouet ou de bracelet. Mais j’ai surtout rééquilibré le récit. Il avait été écrit dans une sorte de brouillard, et pour moi seule. Il passait très vite (deux ou trois lignes) sur ce qui ne m’intéressait pas, et s’attardait au-delà du raisonnable sur les scènes qui me touchaient. Ainsi la promenade qu’Emmanuel de Louvars et le Maudit font sur l’île aux oiseaux occupait un bon tiers du livre dans cette version de mes 17 ans, et c’était cent fois trop. Plus consciente du sens de ce que j’avais écrit, j’ai essayé de le faire apparaître. Prudemment, parce qu’un roman est tout sauf un traité. Disons que j’ai un peu désherbé autour de ce qui me semblait être la ligne directrice : une loi à accepter, représentée par la figure symbolique d’un père, réel ou choisi. (Mais bien sûr je peux me tromper, et d’ailleurs j’ai des amis qui voient dans ce livre tout autre chose.) Une fois refait, ce Maudit est retourné dans la malle de la cave pour dix ou quinze nouvelles années. Je l’en ai ressorti alors, sans raisons bien précises, pour le faire circuler autour de moi comme la plupart de mes autres manuscrits. On l’a traité de « cruel », de « dur », mais en général il plaisait aux gens. Je l’ai donc envoyé à quelques éditeurs, qui l’ont tous trouvé trop court, ou trop violent, ou trop je ne sais quoi… bref, qui n’en ont pas voulu. Il a même fait, plus tard, un court passage sur le net, parce que l’idée de placer un texte sur cette immense toile, comme on lance une bouteille à la mer, m’amusait. Mais à part mes amis personne ne s’est intéressé à ma petite bouteille, et je l’ai reprise très vite. Quelques années ont passé encore. Et c’est en 2004, lors de la parution d’Orfenor chez XO, que le Maudit a refait surface. Bernard Fixot a demandé à lire certains des manuscrits inédits que j’avais, et celui-ci lui a plu.