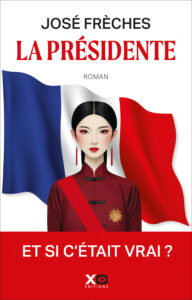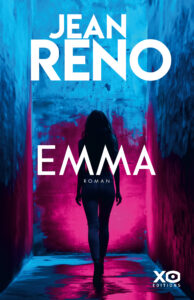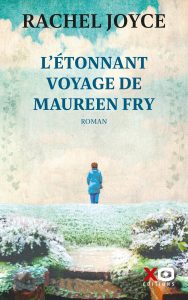Pas uniquement. Certes cela fait vingt ans que j’observe de l’intérieur le monde des affaires, et il va de soi que j’ai puisé dans cette expérience une partie de la matière première de ce livre, encore qu’elle soit totalement transfigurée par la fiction. Mais je suis aussi un « papivore » et un observateur assidu de l’actualité économique, qui regorge d’histoires incroyables, de signaux faibles ou moins faibles d’un monde en mutation rapide. J’ai assemblé une documentation importante pour ce livre, c’est là mon autre matière première : j’accumule des coupures de presse. Et je dois avouer que souvent la réalité dépasse la fiction…
Justement parce qu’il ne s’agit pas que de mécanismes abstraits… Ce sont des individus qui écrivent cette page de notre histoire économique, avec leurs émotions, leurs blessures, leurs peurs, leurs ressorts tendus dans l’enfance… Je ne voulais pas ajouter un essai aux innombrables et excellents livres déjà écrits sur la crise et la mondialisation. D’ailleurs parmi ces livres, ce sont les romans qui m’intéressent le plus. Je crois qu’on ne parvient vraiment à toucher les gens qu’en se donnant la peine de raconter une histoire ; et ce faisant, on approche peut-être mieux une certaine vérité. La fiction est aussi un formidable moyen d’explorer l’avenir, les possibles, de prolonger les tendances. Je pars d’un constat : l’argent gouverne le monde, au-dessus des nations, et Le Bal des Importants est un thriller qui explore la question : où mène cette pente ?
Dans votre roman, les riches d’Occident s’unissent au-dessus des nations pour former une puissance politique et financière inédite. C’est la lutte des classes à l’envers ?
En quelque sorte, oui. Je voulais écrire un livre sur les relations de plus en plus complexes entre les riches, qui vont bien, et les démocraties occidentales, qui ne vont pas bien du tout. Chacun voit que dans le marasme occidental actuel les riches s’en sortent bien : leur nombre ne cesse d’augmenter dans le monde et ils concentrent une part croissante de la richesse mondiale. 0,1% de la population mondiale détient 40 000 milliards de dollars de patrimoine ; aux États-Unis, 4/5e de l’augmentation des revenus depuis 30 ans a profité au 1% les plus riches, qui détiennent un tiers de la richesse du pays. À croire que même les crises leur profitent : l’industrie du luxe n’a jamais été si prospère. Les riches vont bien, donc, mais ils « sont mal » car dans l’opinion ils n’ont pas la cote. Robert Guest, l’éditorialiste du magazine The Economist titrait il y a quelques mois : « Mon conseil aux riches en 2011 : planquez-vous ! ». Ils sont de plus en plus montrés du doigt comme les responsables et les profiteurs de la mondialisation, de la spéculation financière, de l’accroissement des inégalités. Ils sont vus comme des tricheurs et des exilés fiscaux. On leur reproche d’affaiblir la démocratie avec leurs lobbies, de contrôler les médias. Et même quand ils sont philanthropes, certains voient dans cette générosité une suspecte prétention anti-démocratique à vouloir privatiser l’action publique.
Mais ce désamour est réciproque : les riches aussi sont fâchés avec l’Occident. Ils ressentent cette hostilité populaire, ils déplorent que l’Occident soit en déclin et ils y investissent de moins en moins. D’autant qu’avec des finances publiques aussi malades, ils savent bien que la pression fiscale va s’intensifier sur eux. Voilà pourquoi ces relations sont complexes et tendues.
Et c’est là qu’intervient Adrian Assanto ?
Oui. Adrian va comprendre ces inquiétudes et fédérer, grâce à son réseau social baptisé Triple-A, une immense communauté de riches, une sorte de Facebook de millionnaires, qui va progressivement devenir une quasi-nation et une puissance politique et financière. Et en janvier 2012, c’est le coming-out : Triple-A adresse un appel d’offres aux États occidentaux pour sélectionner un pays où s’établir et fonder une société nouvelle. L’opération « Sanctuaire » est une première : jamais une communauté humaine indépendante des nations ne s’est ainsi érigée au-dessus des États pour les mettre en concurrence et tenter d’acheter un pays. Le Bal des Importants est l’histoire de ce passage à l’acte.
Par sa méthode, cet appel d’offres est machiavélique…
Il préserve en effet les apparences libérales et démocratiques : personne n’est obligé de répondre. Et pourtant les démocraties européennes sont au pied du mur : soit elles en acceptent les conditions et s’assurent une prospérité durable, soit elles rejettent cette odieuse régression de la démocratie et prennent le risque de voir partir les riches et leurs capitaux vers d’autres horizons. Car certains pays en difficulté céderont forcément à la tentation…
Croyez-vous un tel scénario possible aujourd’hui ?
En est-on si loin ? J’ai voulu explorer dans ce roman comment, presque insensiblement, le capitalisme occidental a pu en arriver là. Force est de constater aujourd’hui l’effritement du pouvoir des nations dans la mondialisation et face à la toute-puissance de l’argent. L’argent règne, de plus en plus affranchi des États et des lois, avec ses lobbies, ses paradis fiscaux, ses marchés financiers, et maintenant ses fondations humanitaires richissimes qui privatisent aussi la sphère publique. Où nous mène cette logique ? Jusqu’à quel point la démocratie est-elle soluble dans l’argent ? Peut-être ai-je écrit cette histoire pour conjurer le risque d’une telle transgression… Pour qu’on soit prêt, le cas échéant. Mais au fond, on ne saura vraiment si c’est une pure fiction qu’en janvier 2012…
Y-a-t-il quelque chose de nouveau, aujourd’hui plus qu’hier, qui pourrait provoquer une telle rupture ?
Oui. Même si l’évolution que je décris est en marche depuis des décennies, je crois qu’il y aura un « avant » et un « après » 2008. L’explosion de la pauvreté en Occident, le chômage qui ne reflue pas, la démesure des licenciements spectaculaires annoncés ces derniers mois par des entreprises très rentables, le niveau de surendettement des États, l’ampleur des déficits, les fortunes qui échappent à l’impôt dans des paradis fiscaux ou des fondations, la puissance incommensurable des hedge-funds qui sèment la panique sur les marchés comme des voyous dans une cour d’école, tout ça est nouveau, oui, comme d’ailleurs l’accoutumance et la résignation apparente de l’opinion face à cet affaiblissement de l’Occident et la toute-puissance acceptée des marchés. Tout s’achète, alors pourquoi pas un pays ?
Les réseaux sociaux sont-ils capables à vos yeux de favoriser de tels phénomènes ?
La puissance en devenir des réseaux sociaux me fascine. Plus d’un milliard d’humains les utilisent déjà. On a vu encore récemment leur importance dans les révolutions du monde arabe. Et pourtant on n’en est qu’à la préhistoire des réseaux sociaux. Il y a quelques années j’avais été frappé par l’épisode de l’élection d’un président de Facebook. On disait souvent que si Facebook était une nation ce serait la 3e plus peuplée du monde, et puis il y a eu cette élection. Ça avait fait sourire à l’époque, l’affaire était retombée comme un soufflet, mais j’avais gardé en tête cette idée intrigante : et si un réseau social s’organisait et devenait une quasi-nation virtuelle ? Et j’en suis venu naturellement à cette question au cœur du livre : « Si les riches, grâce à un réseau social, devenaient une nation ? »
Qui est vraiment Adrian ? Tout en étant leur leader, il paraît étonnamment sévère avec les riches d’occident…
Adrian est comme beaucoup d’entre eux, un riche financier, un spéculateur, mais il vient d’ailleurs, il a grandi en Allemagne de l’Est, en pleine guerre froide, dans la pauvreté et dans la haine des communistes qui ont assassiné son père. Devenu riche lui-même, il n’en pose pas moins un regard lucide et sans complaisance sur la responsabilité des élites dans le déclin occidental. Pour lui, les riches ont abusé de la mondialisation et de la finance au détriment de leur peuple. Le monde qu’ils ont créé va vers sa chute et il faut réagir. L’irruption d’Adrian est comme un électrochoc, un révélateur. Il fait voler en éclat les certitudes et les sourires figés. Son projet, un peu messianique, c’est d’inverser la logique destructrice des riches, et du même coup sauver l’Occident pour défendre ses valeurs.
Mais son projet fou va se heurter à plusieurs obstacles…
Effectivement, Adrian va d’abord rencontrer l’opposition résolue de Paul, un Français passionnément démocrate et européen, qui voit dans cette opération le dernier acte d’une logique de marchandisation, l’aboutissement d’une ploutocratie rampante, une tentative de viol de la démocratie par l’argent. Le second obstacle, plus dangereux, c’est un autre complot financier d’une ampleur jamais vue, ourdi par les Chinois alliés à Wall Street, un complot qui vise l’Europe.
L’appel d’offres aussi ne s’adresse qu’aux nations européennes. Pourquoi l’Europe ?
C’est en effet la première question des journalistes lors de la conférence de presse à Singapour. Mais ma réponse est un peu différente de celle d’Adrian. Pourquoi l’Europe ? Parce que ce livre est passionnément européen. Adrian et Paul ont un point commun : leur amour de l’Europe et de la Méditerranée. C’est un cri pour défendre l’Europe assiégée par les marchés financiers, à genoux pour placer sa dette, désunie et fragile comme jamais, livrée sans défense à la mondialisation et à la guerre des monnaies. En faisant de l’Europe la cible d’une double conspiration, je voulais montrer que nous sommes une région du monde jalousée et enviée pour ses nombreux atouts dont nous semblons les seuls à ne pas avoir conscience. L’Europe est la première économie du monde, la première épargne du monde, la plus faible inflation, nos problèmes budgétaires sont moindres que ceux des États-Unis et nous sommes la région du monde où la démocratie et l’État-providence fonctionnent encore le moins mal, quoi qu’on en dise. Il est peut-être temps de réagir et de se mobiliser pour la sauver.
Et sauver l’Europe commence apparemment par Athènes. La Grèce est très présente dans votre livre. Pourquoi ?
Comme elle est partout dans notre histoire et notre actualité. Malraux disait qu’une Grèce secrète repose au cœur de tous les hommes d’Occident. Pour Adrian, c’est une affaire encore plus intime : il a été conçu à Athènes, ses parents s’y sont rencontrés et aimés, son père y est mort, son grand-père se prétendait même descendant d’un tyran grec d’Agrigente… La Grèce est le berceau de l’Europe et de la démocratie. Et il y a une ironie douloureuse que ce soit à Athènes, où tout a commencé, que culmine la tragédie financière de l’Europe, et où tout pourrait donc finir. Comment ne pas trouver effrayant de symbolique, que ce soit dans ce pays dont la philosophie des limites nous met en garde contre l’hybris, la démesure qui entraîne la chute, que ce soit précisément là qu’explose notre crise financière ? Aujourd’hui des comptables nous suggèrent d’abandonner la Grèce à son sort, comme si elle n’était pas le cœur et l’âme de l’Europe. Souvenons-nous qu’il y a exactement 2 500 ans, les Athéniens défendaient leur toute jeune invention, la démocratie, et triomphaient de leurs envahisseurs malgré une écrasante infériorité numérique à Marathon et Salamine. Que serait l’Europe aujourd’hui sans leur bravoure d’homme libre ? Camus a répondu à cette question, je le cite : « l’Europe serait ignoble sans les Grecs. »
Parlons de vos personnages. Dans votre galerie de portraits, vous n’êtes pas tendre avec les riches…
Tout dans ce livre parle de l’argent et la manière dont il déforme les comportements et les idées. Le Bal des Importants est un thriller où l’on découvre que le capitalisme financier est devenu un jeu où l’on tire à balles réelles. Avec Barry, l’impitoyable banquier de Wall Street, Reda, le financier originaire du Golfe, spécialiste des raids hostiles et des dépeçages d’entreprises, la belle Sophie, l’espionne de haut-vol droguée au luxe, où encore Liscio, le parrain sicilien, c’est un voyage au cœur d’un monde des affaires cupide et cynique. Le livre montre par exemple comment se prépare une OPA hostile et comment un tel assaut s’apparente pour certains à une traque, une chasse, un sport à haute dose d’adrénaline, et j’ai voulu approcher ces chasseurs comme on fait le profiling d’un serial-killer. Cela étant, sans revenir à Adrian, il y a aussi des figures plus positives parmi tous ces Importants. À commencer par Paul, qui incarne la face morale et européenne de l’opposition à l’opération Sanctuaire. John Aden, le flamboyant hedge-funder, est aussi un riche plus éclairé d’une certaine manière, c’est un faiseur d’argent certes, mais il aime la vie, les gens, l’art de vivre et le raffinement européen, et ça le rend meilleur, plus ouvert… Bernard Aubigny est un capitaine d’industrie qui incarne le capitalisme positif et créateur de valeur. Enfin, on sent chez Sophie la possibilité d’une rédemption et il n’est pas impossible que le stratagème de Paul ait fonctionné : c’est peut-être l’amour, entre Sophie et Adrian, qui va s’avérer le meilleur antidote à l’opération Sanctuaire…
À l’inverse, Le Bal des Importants présente une vision terrible des pays émergents. Sont-ils une telle menace ?
Il n’y a pas de diabolisation des pays émergents. La conspiration « Eurostuff », par exemple, vient autant des banques de Wall Street que de leurs alliés de circonstance, chinois. De même, un de mes personnages, Vageesh Patel, incarne l’Inde dynamique, démocratique, ouverte, un visage rassurant s’il en est de la mondialisation. On ne peut que se réjouir que, grâce à la mondialisation, des millions d’hommes et de femmes des pays émergents sortent de la pauvreté. Mais il est permis de regretter que dans le même temps, des millions d’Occidentaux y entrent… Ce qui est terrible pour l’Occident, ce sont certains effets de cette mondialisation non régulée. Il faut bien comprendre que c’est exactement comme si on faisait revenir des patrons et des ouvriers de la France de 1890 dans la France d’aujourd’hui… Là encore, où mène cette pente ? Adrian prend simplement le point de vue des Européens et des Américains. Quant aux Chinois, ne croyons tout de même pas trop naïvement à leur soutien sans contrepartie. Ils s’intéressent à nos usines, nos infrastructures, nos entreprises, ils jouent leur partie avec sang-froid et intelligence.
Vous êtes très dur avec Wall Street et la finance en général. Sont-ils si coupables des maux de l’Occident ?
La responsabilité des hedge-funds et des banques d’investissement américaines dans les crises et les désordres économiques mondiaux a déjà fait l’objet de nombreux livres. Les Américains tiennent les banquiers de Wall Street pour des délinquants. Le Tea Party pousse notamment sur ce terreau. D’ailleurs la critique la plus dure vient de l’intérieur : Michael Lewis (« the Big Short ») était un ancien trader, Gillian Tett (« Fools Gold ») est éditorialiste au Financial Times, sans parler de la fameuse « Lettre d’adieu à Wall Street » d’un brillant hedge-funder qui a tiré sa révérence. La finance de marché est une industrie surpuissante en liberté non surveillée. Tout le monde sait par exemple que les produits dérivés et la titrisation ont permis de faire exploser les risques de crédit et les dissimuler dans des angles morts de la réglementation. Greenspan reconnaissait en 2008 qu’il avait eu tort de s’opposer à la réglementation des CDS (qu’il jugeait publiquement « inutile » encore en 1998, quelques mois avant l’affaire LTCM). Mais la réglementation sur les dérivés de crédit n’a pas beaucoup avancé depuis. Et à nouveau une meute de hedge-funds cherche à briser l’Europe…
Votre roman semble appeler une suite. L’envisagez-vous ?
L’histoire mouvementée des relations entre les riches et la démocratie est en marche, elle n’est bien sûr pas finie. Si l’on s’en tient à mon livre, l’opération Sanctuaire, cet appel d’offres aux nations occidentales, sera bientôt sur la table. Pour l’heure, Adrian est en mer, à bord de son trois-mâts quelque part dans l’océan Indien, et fait route vers Singapour, où doit se tenir une conférence de presse qui va changer le monde. Attendons janvier 2012 donc. La suite appartiendra-t-elle à la fiction ? Ou la réalité dépassera-t-elle la fiction ? Mes lecteurs en tout cas seront prêts.
Vous avez pris un nom de plume, pourquoi ?
Pour marquer une séparation claire entre ma vie professionnelle et mon travail d’auteur. Pour circonscrire, et protéger, cette voix propre à l’écriture, cet autre « Je ». Et pour rester monsieur tout-le-monde en dehors de mes livres.