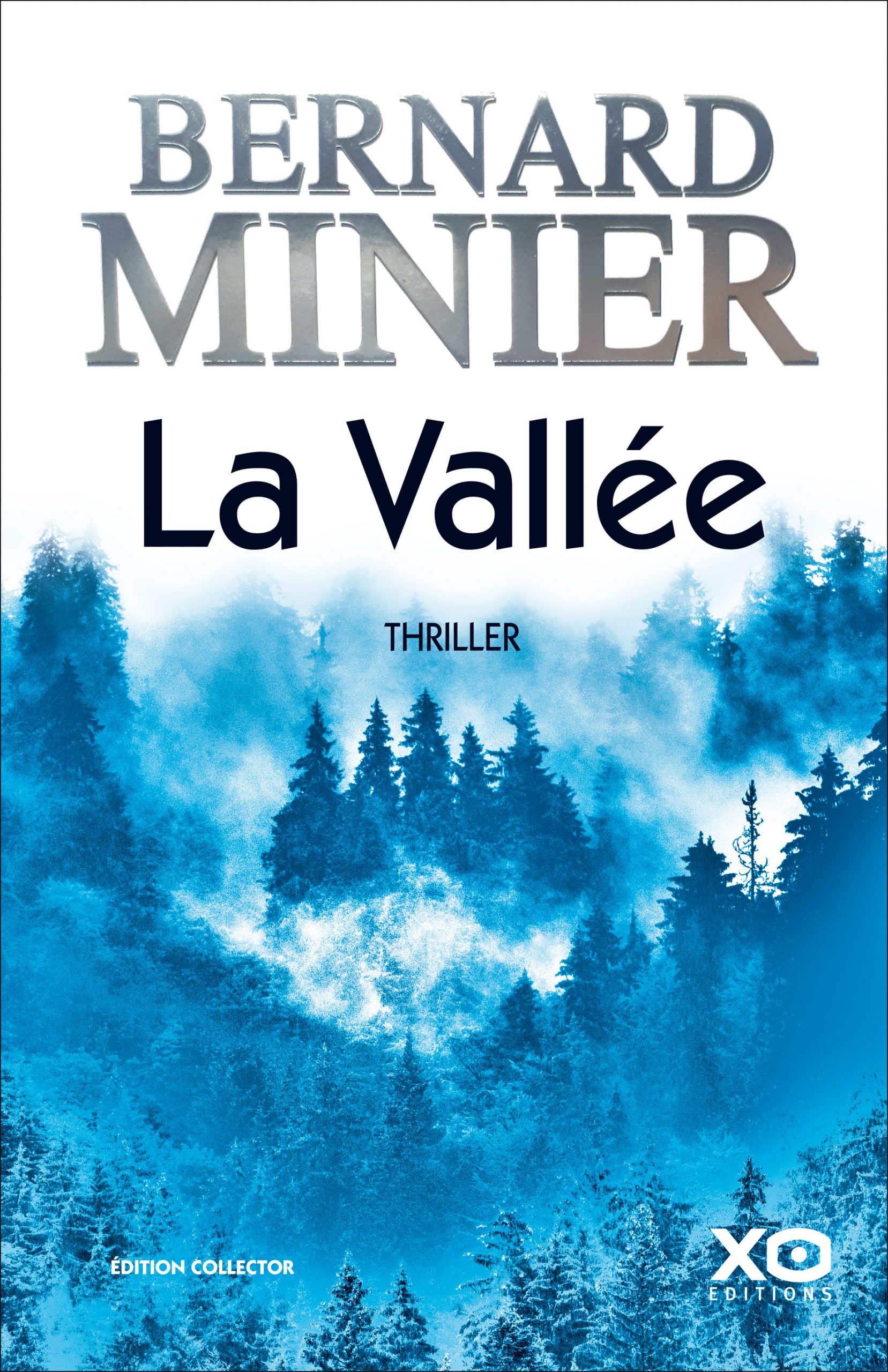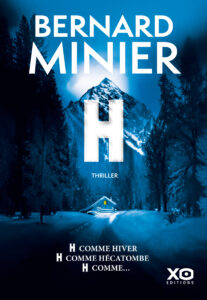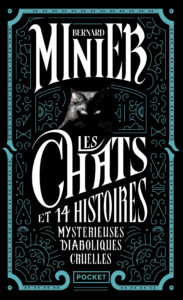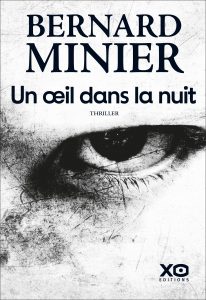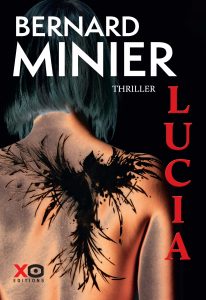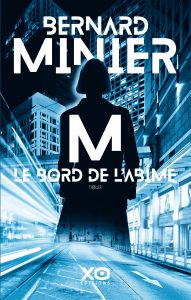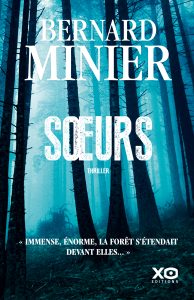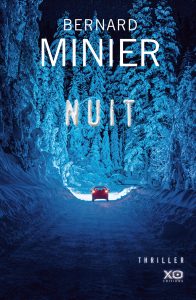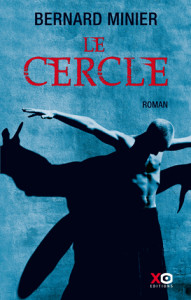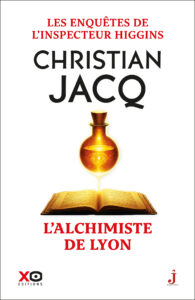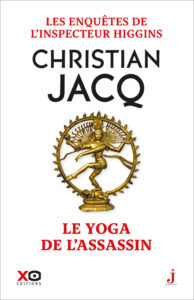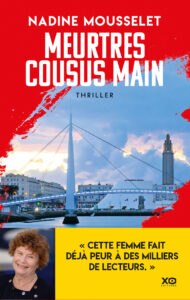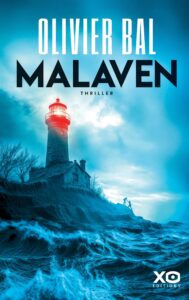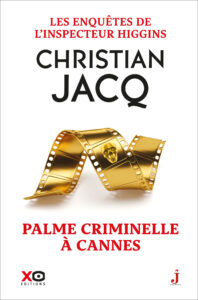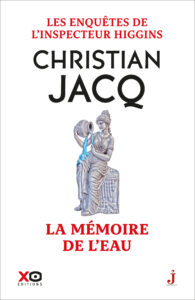Une vallée coupée du monde, c’est le décor, presque en huis clos, que vous avez choisi comme cadre de ce huitième roman. Expliquez-nous pourquoi…
J’ai toujours aimé enfermer mes personnages, c’est étrange de dire ça compte tenu de ce que nous vivons, mais il faut préciser que le roman a, bien entendu, été écrit avant la terrible épreuve que nous traversons. Comme ceux de Glacé ou encore les ados d’Une putain d’histoire qui sont eux aussi enfermés dans une vallée ou sur une île. Cela rend tout infiniment plus fort, plus tendu et plus dangereux quand les personnages sont coincés les uns avec les autres et livrés à eux-mêmes. Ici, la vallée du titre est coupée du monde à cause d’un pan de montagne qui dégringole sur l’unique route d’accès. Comme je n’invente quasiment jamais à partir de rien, je me suis basé sur un fait réel. En 2019, la route reliant la France à l’Andorre a été coupée par un éboulement semblable. Or, cette route est le seul accès aux très nombreux commerces détaxés d’Andorre et son trafic est de plusieurs milliers de voitures par jour. Et pourtant, il a fallu quinze jours pour la rouvrir. La route de ma vallée est infiniment moins fréquentée et la communauté qui vit dans cette petite ville au cœur des Pyrénées va se retrouver coupée du monde avec un terrible assassin en son sein. Ça m’intéressait de voir comment chacun allait réagir dans de telles circonstances. Depuis, comme je l’ai dit, l’actualité m’a rattrapé et nous sommes de plus en plus enfermés et coupés les uns des autres, comme chacun sait. Le huis clos de La Vallée fait assez incroyablement écho à tous les huis
clos mis en place un peu partout. Dans La Vallée comme dans la vie réelle, les gens ne peuvent plus aller travailler, les enfants sont privés d’école. Je le répète : ce roman a été écrit avant. Mais voilà qu’on va enfin sortir de cet enfermement, se retrouver, renouer avec la vie d’avant, même si elle ne sera plus tout à fait celle qu’on a connue, retourner dans les librairies enfin.
Il est aussi question d’une abbaye pleine de secrets. Était-ce pour vous l’occasion de développer une réflexion sur le Bien et le Mal ?
Cela, je crois, va au-delà : cette vallée et cette petite ville sont à l’image de la société et de l’époque actuelles, une époque d’hyper-moralisation, de juges, de censeurs, d’inquisiteurs anonymes ou non. Comme l’a dit Éric Dupond-Moretti, « on est dans une époque moralisatrice qui nous conduit en permanence au manichéisme, c’est le blanc ou le noir sans aucune nuance, c’est les uns contre les autres et les uns qui deviennent les censeurs des autres ». On ne peut mieux dire… On vit une époque terrible, où trop de gens – pas tous, loin s’en faut – ont besoin de juger avant de comprendre, de détruire ceux qui ne pensent pas comme eux, de se trouver des ennemis. Le choix d’avoir campé une partie de l’action dans une abbaye, de son côté, permet de confronter le passé à l’époque actuelle mais aussi de parler de cette obsession de la pureté qui devient la nôtre : c’est effrayant. Qui peut se targuer d’être absolument bon, d’être absolument pur ? Ça n’existe pas. Et puis, Servaz n’est pas croyant, n’est pas religieux, mais quand il entend ces chants qui s’élèvent dans la nuit, il est ému, il est saisi par leur beauté. Et il est, comme moi, fasciné par l’architecture et l’art chrétiens sans être chrétien lui-même.
La colère déborde dans votre histoire. Celle d’une population qui n’a plus confiance dans ses représentants, mais aussi d’une police au bord du burn-out. Le romancier se fait-il le peintre de tensions qui traversent nos sociétés ?
Peut-être parce que je suis moi-même en colère (sourire). En colère contre ce besoin de déverser la haine en permanence sur les réseaux sociaux, de juger les autres sans même savoir vraiment de quoi on parle, en colère contre cette culture du bouc émissaire. Toute cette rage… C’est également de ça que parle La Vallée, dont la communauté va se déchirer, où on va voir apparaître les mêmes fractures que dans le reste de la société : c’est un des grands sujets du livre. La confiance est brisée. Entre la population et ses représentants, entre la population et l’autorité, entre la population et les médias ou les élites, mais aussi au sein de la population elle-même. Et, en même temps, on voit apparaître aujourd’hui de nouvelles solidarités, des groupes WhatsApp se créent entre voisins, on applaudit les soignants, on s’entraide davantage alors qu’on se croisait sans se voir. Et puis, ça parle enfin du malaise dans la police. N’oublions pas que Servaz est flic…
Il voit donc forcément ce malaise de l’intérieur – même si on sait depuis Glacé que Martin n’est pas un flic comme les autres…
Votre roman fait la part belle aux personnages féminins, un médecin, une mairesse, mais aussi une psychiatre redoutable. Question de parité ou prétexte à explorer les relations subtiles entre les deux sexes ?
Ce n’était absolument pas prémédité. C’est venu comme ça : ces personnages de femmes se sont imposés au fur et à mesure du récit et je dois dire que j’ai pris un plaisir infini à les faire vivre. Mais il faut se souvenir que, dès Glacé, les femmes prenaient le dessus sur les hommes puisque dans le duo Servaz-Ziegler, j’avais déjà pris un malin plaisir à inverser le traditionnel binôme masculin-féminin des récits policiers : c’était Irène la plus physique, la plus entreprenante des deux, la plus querelleuse aussi, alors que
Martin était plutôt l’élément modérateur et le frein du duo.
J’aime beaucoup les trois personnages féminins que vous venez de citer, mais il y en a d’autres. C’est vrai qu’il y a dans ce roman presque plus de femmes que d’hommes. Et ça parle aussi, bien sûr, de ce qui a changé dans les rapports entre les uns et les autres à l’heure de « me too ».
Inutile pour le lecteur d’avoir lu les précédentes enquêtes de Servaz pour suivre l’affaire, mais les aficionados, eux, apprécieront les clins d’oeil à vos premiers livres, ainsi que le retour d’un personnage majeur. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Justement, il faut laisser la surprise au lecteur, et je crois que ce sera une surprise très agréable. Car ce n’est pas un mais deux personnages majeurs qui vont réapparaître dans La Vallée, des personnages qu’on avait un peu perdus de vue, mais qui occupaient une grande place dans les premiers romans – je n’en dis pas plus…
Avant d’écrire, vous passez beaucoup de temps à vous documenter. À quoi ressemblait votre bureau quand vous avez posé le mot FIN ?
Un chaos. Pas seulement mon bureau : mon salon, ma maison ; il y avait des dizaines de dossiers, de livres, d’articles sur le sol, sur le bureau, sur les tables, partout. Le roman avait métastasé dans tous les coins. Je construis mes histoires à partir du réel : il offre une infinité de sources d’inspiration, d’émerveillement et d’effroi ; il ne laisse jamais de me surprendre ; la nature, l’humanité, le monde moderne ont beaucoup plus d’imagination que moi. Dans les grandes comme dans les petites choses, je puise dans le réel. Cela demande beaucoup de travail en amont. Je déteste les romans où on décrit des lieux, des situations, des métiers sans souci de réalisme ni d’exactitude. Non, la fiction n’autorise pas tout. C’est du réel qu’on part et qu’on parle. Les bons romans font leur miel de l’expérience humaine ; pas de bonne histoire sans vécu. La seule morale du roman, c’est de tenter de s’approcher de cette vérité humaine dans toute sa complexité et dans toute sa richesse, ne pas simplifier et ne surtout pas sombrer dans les caricatures qui ont suffisamment cours par ailleurs de nos jours. Plus que jamais en ces temps de fake news, de complotisme et de simplification, le romancier a une responsabilité vis-à-vis de son lecteur.
Peut-être est-ce trop tôt pour le dire mais retrouverons-nous Servaz dans votre prochain roman ou vous accorderez-vous, comme avec Le Bord de l’abîme, un nouveau pas de côté ?
Il se trouve que ce roman-ci n’était pas fini que déjà je pensais au prochain (l’usine à idées, là-haut, ne s’arrête jamais) et… je crois bien que Servaz sera du voyage – du reste, le mot « voyage » n’est pas employé ici par hasard.
En espérant qu’il redevienne bientôt un terme d’usage courant.