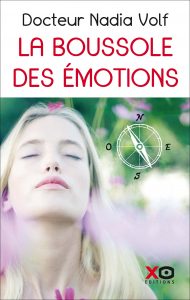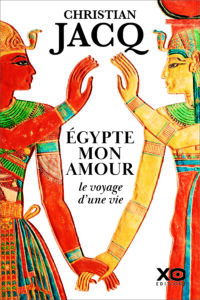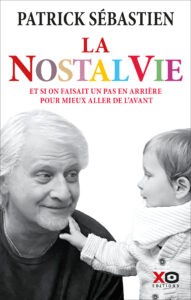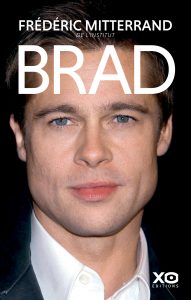En découvrant la médecine, à 14 ans, j’ai eu le sentiment de comprendre enfin pourquoi j’avais été mise au monde. Trois ans plus tôt, à la suite d’une maladie, j’avais été chassée de l’académie de danse Vaganova, et cela m’avait laissée dans une grande détresse. J’avais rêvé d’être danseuse, et, soudain, on ne voulait plus de moi. Alors quelle était donc ma destinée ? Où se cachait-elle ? Fervents communistes, mes parents avaient le sens du devoir. Ils disaient que chacun est ici pour mettre ses talents au service du bien commun. Au nom de ce principe, mon père dirigeait l’Institut de chimie contre un salaire inférieur à celui d’un ouvrier, et ma mère enseignait la médecine. Mais moi, quels étaient mes talents ? Je me sentais inutile, décevante aux yeux de mes parents, et, certains jours, j’avais envie de mourir. Jusqu’à cette rencontre avec le docteur Maria Sergéevna. Je la vois sauver mon père d’une grave crise d’asthme, et, après quelques jours, j’ose lui demander de m’enseigner cette science qui permet de conjurer la mort. Je crois qu’à cet instant tout est dit : je serai médecin, ou je me perdrai. Cette femme a sauvé mon père, sous mes yeux, comment imaginer plus belle mission sur la terre que de soigner, et de sauver si possible ? Du jour où j’ai décidé de faire médecine, je me suis sentie ressuscitée : j’ai trouvé mon étoile. Je crois que c’est cette certitude d’avoir trouvé ma place qui m’a donné la force de brûler les étapes à la Faculté de médecine de Leningrad, et, plus tard, en France, l’énergie de repasser mes diplômes. À ces moments-là, c’est vrai, j’ai eu la conviction que je ne survivrais pas à un échec.
Vous êtes donc médecin, vous vivez en France depuis les années 1990, mais vous êtes née à Saint-Pétersbourg, et vous racontez dans ce livre les conditions éprouvantes de la vie d’une femme juive, et plus encore d’une femme médecin en Russie.
On ne mesure pas en France la violence de l’antisémitisme en Russie. On a parfois l’impression que cette violence appartient au passé, mais je l’ai vécue et je n’ai que 44 ans. En Union Soviétique, être Juif était une nationalité, au même titre qu’être Russe, ou Ukrainien. C’est écrit sur notre passeport, à la cinquième ligne : Evrey (Juif). « Parce que tu es juive, Nadia, tu devras travailler dix fois plus que les autres si tu veux réussir », me répétait mon père, enfant. Mes parents admettaient cela comme une fatalité. Devenue directrice de son laboratoire de recherche, ma mère en avait été mise à la porte parce qu’elle était juive, et je ne peux pas oublier son visage ce jour-là. Elle avait vieilli de dix ans, elle était révoltée, mon père affreusement triste, mais ils n’envisageaient pas pour autant de quitter leur pays.
C’était comme ça, il fallait travailler dix fois plus que les autres pour mériter sa place. J’ai travaillé dix fois plus, je suis sortie première de ma promotion, j’ai été nommée professeur à 25 ans, mais malgré cela on n’a pas voulu de moi. On m’aurait peut-être tolérée comme petit médecin dans le sous-sol d’un hôpital, mais une juive professeur à la Faculté de Leningrad, ça n’était pas envisageable. À partir de là, le cauchemar a été quotidien. Des hommes du KGB nous ont cambriolés, on nous a mis sur écoute, on m’a convoquée, puis arrêtée… Il vient un moment où l’on comprend que tout cela va se finir en drame. Et puis voulions-nous que notre enfant vive la même chose ? Il ne nous restait plus qu’à fuir.
Dans quelles conditions vous et votre famille vous êtes-vous enfuis ? Pourquoi avoir choisi la France ?
Nous avions, mon mari et moi, l’occasion de participer à un programme de recherche en France, nous avons saisi cette chance, ne sachant pas si nous pourrions rester. La France nous admettait sur son territoire pour trois mois, mais la Russie ne voulait pas nous laisser partir, et nous nous sommes enfuis grâce à un visa de trois jours pour la Finlande, notre petit garçon caché dans le coffre de la voiture. Nous étions prêts à prendre tous les risques pour partir. Si nous sommes restés en France, c’est que le gouvernement a bien voulu nous attribuer le statut de réfugiés politiques. À partir de ce moment-là, nous avons pu travailler et recommencer notre vie.
Vous avez vécu dans un grand dénuement à votre arrivée en France, mais vous avez été secourus par des gens formidables. Comment expliquez-vous ces rencontres « à bon escient » qui semblent jalonner votre vie ?
En débarquant à Nîmes, nous avons vécu plusieurs semaines à la Croix-Rouge, dans une chambre seulement meublée de lits superposés, sans moyen de faire la cuisine. Avec le peu d’argent que nous avions, nous achetions des sandwichs que je faisais réchauffer pour notre fils sur le radiateur. C’était extrêmement dur, et cela nous paraissait sans espoir. Jusqu’à ce qu’entrant par hasard dans la synagogue, on nous conduise chez la seule personne qui parlait le russe à Nîmes, un homme du nom d’Elie Storper. Lui et sa femme, Monique, ont été extraordinaires : ils nous ont ouvert leur porte, trouvé un logement, et bientôt ils ont mobilisé autour de nous des gens d’une grande générosité qui demeurent aujourd’hui notre famille d’adoption. Pourquoi ont-ils fait tout cela pour nous ? Elie Storper avait connu la même détresse en arrivant en France, juste après la guerre…
Vos diplômes – et pas des moindres, major de la faculté de médecine de Leningrad, docteur en médecine et ès sciences – n’étaient pas valables en France. Vous les avez repassés en deux ans – avec le recul, diriez-vous que le système d’accueil des médecins étrangers est bien fait ?
C’est difficile, mais il nous offre la possibilité d’obtenir notre équivalence sans avoir à refaire les sept ou huit années d’études, et ça c’est bien. La plus grande difficulté ne concerne pas le système, elle réside en réalité dans l’apprentissage de la langue. Dès que j’ai pu parler français, je n’ai pas eu de mal à être reçue à tous les examens.
Êtes-vous retournée en Russie depuis votre fuite ? En auriez-vous l’envie ?
Non, je ne suis jamais retournée en Russie. Si je ne tremblais pas en me remémorant nos dernières années à Leningrad, j’aimerais y retourner avec Leonid et notre fils, oui. Mais j’aurais trop peur que l’un d’entre nous soit arrêté, ou qu’on nous crée de tels problèmes que nous nous retrouverions de nouveau plongés dans ce cauchemar.
Beaucoup de gens pensent inconciliable d’être médecin et spécialiste de l’acupuncture. Que représente la médecine dite douce, pour vous ?
Comme me l’avait expliqué le docteur Maria Sergéevna : si tu veux un jour pratiquer l’acupuncture, il faut d’abord faire ta médecine. Un acupuncteur est d’abord un médecin. L’acupuncture ne relève pas de la magie, ni de la sorcellerie, mais d’une science autrefois empirique, dont nous commençons aujourd’hui seulement à expliquer scientifiquement l’efficacité.
Avec ce livre, on sent une page qui se tourne dans votre vie. Comment voyez-vous les prochaines années ? Pensez-vous vous consacrer à la recherche ?
Je me sens pleine de reconnaissance pour la France qui nous a accueillis, et nous a rendu notre dignité. Comme je l’écris à la fin de mon livre, j’aimerais rendre à ce pays un peu de tout ce qu’il nous a donné, et la médecine est évidemment pour moi le seul moyen de manifester ma gratitude à la France. J’aimerais contribuer à une meilleure compréhension scientifique de l’acupuncture, j’aimerais aider les gens à vivre mieux dans leur corps, j’aimerais découvrir des vérités qui nous sont cachées, j’aimerais comprendre, et faire connaître, certains des mécanismes qui entraînent le cancer. J’aimerais être plus utile encore que je ne le suis aujourd’hui dans mon cabinet.