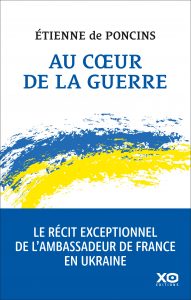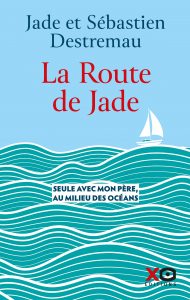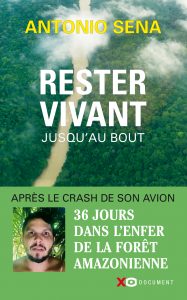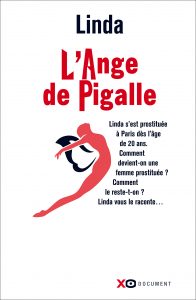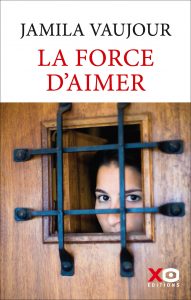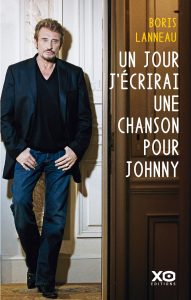Nous étions partis en reportage pour France 2 afin de faire un point sur la situation à Jolo. Nous voulions être présents à l’antenne à l’occasion du 14 juillet en France avec un reportage sur la situation des négociations et celle des otages. Nous avions établi un contact par un intermédiaire qui était déjà connu, puisque d’autres journalistes étaient passés par lui pour rencontrer les ravisseurs, qui répondaient aux noms de code de « Robot » et de « Mudjib ». Nous avions rendez-vous avec eux. Nous n’avions pas l’obligation, de la part de notre chaîne, d’aller au contact des otages. Nous devions faire un point depuis de Jolo, mais on nous avait dit que si l’opportunité se présentait de faire l’aller et retour sans problèmes, on pouvait y aller. Nous étions absolument sûrs à 100 %, puisque nous avions le contact avec Mudjib et Robot, de faire l’aller et retour et de pouvoir rencontrer et les ravisseurs et les otages. Et les choses ont foiré, on ne sait pas trop bien pourquoi, peut-être que notre intermédiaire nous a vendus, peut-être que des gens dans la mouvance de Robot et Moudjib n’ont pas voulu que l’on reparte, ont souhaité être eux-mêmes des ravisseurs et ont imposé en quelque sorte à Robot et Moudjib de nous retenir. Il y a eu un moment de flottement.
Quand avez vous compris que l’affaire tournait mal ?
Dès notre arrivée, quand on a été évacués du véhicule d’une manière qui n’était pas tout à fait conviviale, on s’est dit que les événements ne prenaient pas forcément la tournure prévue. Et puis on nous a un peu trimbalés dans la jungle et, très vite, Robot s’est présenté. On se disait que, jusque-là, tout allait à peu près bien. Mais il avait l’air très ennuyé, il a dit : « mais non, j’avais demandé à ce qu’il n’y ait plus de journalistes. Je suis embêté, embêté… » Et tout de suite, il nous a fait le cinéma du type un peu dépassé, qui n’est pas responsable des événements et qui est très très ennuyé. On nous a ensuite promenés pour aller voir les otages philippins, les évangélistes de la Jesus Miracle Crusade. On a fait une interview de Robot, une interview de Mudjib. On s’est encore dit que tout allait bien… Jusqu’au moment on nous mis debout, on nous a dépouillés, et on nous a annoncé : « Maintenant, vous allez rester ici et on va réfléchir à votre situation pendant quelque temps. » Le lendemain, on nous a fait téléphoner pour transmettre quelques exigences de rançon et autres. Robot disait : « Non, c’est pas moi, c’est un autre, moi je ne suis qu’un facilitateur. » On nous a dit aussi : « Non, c’est l’autre qui vous détient ! » L’autre, c’était un monsieur qui s’appelait Abousabar, responsable effectivement du camp dans lequel on était. Lui affirmait qu’il était aux ordres de Mudjib… Tout le monde se renvoyait un peu la balle. Tout le monde faisait celui qui était embêté, tout le monde jouait double ou triple jeu.
Quelles étaient vos conditions de détention ?
Pendant deux mois et dix jours, on est restés dans ce camp, dans des conditions dont je dirais qu’elles n’étaient pas cruelles si l’on fait la comparaison avec celle d’un certain nombre d’otages qui ont connu des conditions de détention beaucoup plus douloureuses que les nôtres. Évidemment, vous êtes totalement privé de votre liberté et vous êtes dans l’inconnu total par rapport à l’issue de la situation dans laquelle vous êtes, à la fois en terme de durée et de condition physique – puisque plane toujours le fait que vous savez que les choses peuvent mal tourner un jour, donc votre vie est quand même tenue en suspens -, vous vivez tout de même dans l’idée que la mort peut surgir en permanence. Mais les conditions matérielles, nourriture, sommeil, hygiène, n’étaient pas horribles. On avait de quoi manger comme eux, ensuite comme on a pu recevoir des colis de France 2, on pouvait même manger mieux qu’eux. On avait de quoi dormir comme eux. Et ensuite, comme on a reçu des matelas, mieux qu’eux. Et puis on allait se laver à l’occasion à la rivière, accompagnés de quelques rebelles, dans une eau qui reste une eau de rivière, avec les risques que cela suppose dans les pays tropicaux.
Vous avez parlé de l’attitude confuse au sein de ce groupe. Est-ce à cause du manque de structure, au point qu’on ne sait pas trop qui dirige véritablement et quels sont leurs véritables motifs ?
Il y a deux éléments. D’une part, ils jouent, de manière à brouiller un petit peu les cartes, genre « ce n’est pas moi c’est l’autre, mais je vais faire en sorte que ça se passe bien pour vous », histoire de s’attirer notre sympathie. Et puis derrière tout ça, il y a quelque chose d’assez structuré chez ces bandits qui ont monté une entreprise crapuleuse consistant à se faire de l’argent avec des otages. Ceux qui ont organisé l’enlèvement des otages en Malaisie, l’équipe de Mudjib et de Robot, ont préparé une opération pirate assez complexe puisqu’il fallait quand même aller les chercher, les ramener, vingt heures de bateau, une grosse organisation. C’était beaucoup moins glorieux et moins difficile de retenir des journalistes avec qui ils avaient pris rendez-vous ! Mais il y avait quand même des patrons derrière qui étaient les interlocuteurs avec lesquels se sont retrouvés l’ensemble des négociateurs. Et au fur et à mesure que cette situation a duré, ils avaient de plus en plus d’argent, puisque quelques négociations avaient aboutie… Donc leur popularité augmentait à l’intérieur de l’île, et de plus en plus de jeunes venaient grossir leur troupe et leur rang, parce que le salaire était quand même attrayant. Or il y avait un fond de répression dans cette île depuis des siècles, et il devenait assez naturel, quand on est en âge de combattre, de rentrer dans une pseudo résistance, suite aux souffrances qu’avaient pu endurer les parents, les grands-parents.
Étiez-vous en contact avec les autres otages, ceux qui étaient retenus là depuis le 23 avril 2000 ?
Oui, ce sont eux qui sont venus nous rendre visite les premiers, ce qui était d’ailleurs étonnant puisque nous étions venus à l’origine pour les rencontrer ! Mais eux connaissaient mieux les rouages et les ravisseurs. Ils ont demandé au bout de quelques jours après notre enlèvement à nous rencontrer. Ensuite on s’est rendu des visites assez régulières. On allait dans leur camp, ou ils venaient dans le nôtre. On prenait un café, on discutait. Ensuite, il y a eu une période où on a cru sentir que l’ambiance était légèrement plus tendue, plus incertaine. Il y avait des rebelles un peu incontrôlés dans la jungle et qui faisaient parler d’eux, on a eu peur d’être interceptés et on a limité nos mouvements. Et puis on a recommencé à se voir quand les femmes ont été libérées le 28 août. Il restait Roland et moi de notre côté, et Stéphane, un Allemand, Mark Walert et les deux Finlandais de l’autre. On a recommencé à se rendre visite, on échangeait nos informations, nos livres et parfois un peu de nourriture.
Qu’est ce qui vous a décidé à tenter de vous évader ?
Je venais de lire le livre d’Henri Amouroux, La Grande Histoire des Français sous l’Occupation. Il raconte la débâcle, puis l’arrestation par les occupants allemands des Français en âge de combattre. Lors de ces rafles, 62 000 Français se sont évadés. J’ai pensé, lorsque je me suis retrouvé dans ma propre débâcle, et que le président Chirac exprimait ses inquiétudes après l’intervention militaire philippine, qu’il fallait que nous prenions notre sort en main. L’évasion n’était plus alors une question de courage, mais une question de devoir. Cela a rendu la réflexion beaucoup plus facile. Henri Amouroux et le Jacques Chirac sont en grande partie les instigateurs de cette évasion, sans compter mon ami Roland qui, lui, était convaincu avant moi que c’était la meilleure issue.
Et c’est au cours d’une opération militaire que vous avez choisi de partir…
L’opération militaire est intervenue dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 septembre, alors que la négociation pour Roland et moi, les deux derniers otages occidentaux, avait abouti, et que nous devions être libérés cette nuit là. Le commandant Robot, le fameux ravisseur, avait rendez-vous et était déjà en route pour récupérer la rançon quand il s’est trouvé au contact des militaires, que les militaires ont bloqué l’opération, et ensuite ont attaqué dans la nuit. Là, on nous a écartés de l’endroit où on dormait normalement. Et le lendemain matin, les bombardements ont commencé. Les avions nous ont survolés. On a bien entendu des bombardements un peu plus loin, et là ils ont décidé de fuir dans la jungle. On est partis en colonne et on a marché jour et nuit, pendant quatre jours, pour fuir les zones où nous étions systématiquement repérés par les avions. On sentait bien avec ces bombardements aériens que l’opération militaire n’était pas vraiment une opération de sauvetage des otages, que les militaires faisaient assez peu de cas de notre survie, en tout cas les méthodes employées ne permettaient pas de nous récupérer.
Ce ne sont pas les militaires qui vous ont sauvé ?
Non, absolument pas. Il faut être très clair là-dessus. L’armée philippine a tiré une grande gloriole de nous avoir récupérés, et je leur laisse leur gloire. Ce qui s’est passé, c’est que dans les conditions dans lesquelles nous étions détenus dans le camp où nous étions auparavant, avec une île et une population complètement complices, il était évidemment inimaginable d’envisager une évasion. L’opération militaire sur le territoire de l’île de Jolo, avec 4 000 soldats au sol et les bombardements aériens, faisait que si nous nous échappions à ce moment-là, nous avions des chances de rencontrer des forces militaires. Et les civils, passablement secoués par les bombes, craignant pour eux-mêmes, ne nous auraient peut-être pas immédiatement remis dans les mains des Abou Sayyaf.
Un soir, on a repris la route parce que notre position avait été repérée par les avions. La nuit était très noire, il fallait pratiquement toucher la personne devant pour avancer, on marchait en colonnes sur des chemins étroits… Roland voulait qu’on se jette dans le premier trou noir pour nous cacher… Moi, je voulais absolument qu’on attende de traverser un axe routier sur lequel on aurait pu se repérer ou, en tout cas, faire des rencontres qui auraient pu nous sauver. Et à huit heures du soir, alors qu’on marchait depuis une heure et que ça faisait quatre jours qu’on se déplaçait tout le temps, on était très fatigués, on a traversé une route, ce qui a provoqué une cohue. Ils se sont tous précipités de l’autre côté de la route mais il fallait alors s’engouffrer dans un chemin qui faisait 50 centimètres de large. Et là, il y a eu une espèce de bouchon infernal, avec les rebelles qui couraient pour dépasser tout le monde dans une sorte de sauve-qui-peut, parce qu’ils avaient peur d’être aperçu sur la route par une patrouille militaire. Nous, on en a profité pour sauter sur le côté, pour se cacher dans le noir pendant cinq à dix minutes. Là, on a vu tous les rebelles continuer à courir et avancer dans la colonne. Et on s’est retrouvés seuls. On est partis en courant, on a fui. Un chien dans une maison s’est mis à hurler à la mort, on s’est retournés et on a cru à ce moment-là qu’ils essayaient de nous rattraper. On a plongé dans la jungle.
On a passé toute la nuit là, pendant huit heures à se terrer, sans faire de bruit, pour que surtout s’ils nous cherchaient ils ne nous retrouvent pas. Huit heures immobiles, cachés par des feuilles de bananier, recroquevillés sur nous-mêmes, en essayant à l’occasion de trouver un peu de sommeil puisqu’il n’y avait que ça à faire, avec la ferme idée de ne pas émettre le moindre bruit au cas où ils chercheraient éventuellement à nous retrouver. À quatre heures du matin, il y a eu une averse – la pluie est bruyante là-bas. Couverts par ce bruit, on est ressortis de notre tanière, on a regardé sur la route, et dans cette position on a vu une lumière. C’était une lampe devant une maison. Comme les rebelles avaient eu très peur en traversant la route, ils avaient dû marcher au minimum un quart d’heure avant de faire une pause. Peut-être ne se sont-ils aperçus de notre disparition qu’au bout de ce quart d’heure et, à ce moment-là effectivement, il était pour eux absolument inutile de faire marche arrière pour nous retrouver dans la jungle, parce que c’était comme rechercher une aiguille dans une botte de foin.
On a d’abord marché le long de la route, puis un peu plus confiants, quelques moments plus tard, on est remontés sur la route et on a continué pendant trois ou quatre kilomètres en ayant l’impression, d’après ce qu’on avait cru observer avec notre vague sens de l’orientation, de se rapprocher de Jolo. Et on se disait qu’il y avait un check point de l’armée des Philippines à l’entrée de la ville, ou à quelques kilomètres, on avait donc espoir de se rapprocher de plus en plus de ce check-point. En fait, on a découvert ensuite qu’on s’en écartait ! Mais il fallait de toute façon s’écarter au maximum de l’endroit où on avait faussé compagnie à nos ravisseurs. Il y avait quelques maisons autour, quelques lampes par-ci par-là, et au lever du jour, vers cinq heures, cinq heures et quart, quand on a commencé à voir que des gens bougeaient à l’intérieur de chez eux, qu’on a aperçu une personne dans son jardin, là on a décidé de se cacher de nouveau parce qu’il y avait toujours cette incertitude, si on tombait sur un civil, qu’il appartienne à la famille des Abou Sayyaf… On s’est donc recachés auprès de la route, à quatre mètres derrière des buissons, et on a décidé d’attendre que des taxis brousses, qu’on appelle là-bas des jeepney, passent, pour essayer de déterminer, en fonction de leurs passagers, avec ou sans bagages, ou bien s’ils roulaient à vide, la bonne direction pour Jolo. Ensuite, nous pensions intercepter un jeepney pour lui demander de nous amener à Jolo rejoindre les militaires. En fait, les deuxièmes véhicules qui sont passés, à six heures et demie, étaient des véhicules de l’armée. On s’est découverts, on les a appelés; on a expliqué qui on était, ils ont mis un peu de temps à comprendre, puis ils nous ont raccompagné vers Jolo en se congratulant tout au long du chemin.
Est-ce que vous croyez que si les ravisseurs vous avaient rattrapés, ils vous auraient exécutés ou simplement ramenés dans le groupe ?
C’est difficile à dire. J’avais préparé quelques réponses humoristiques pour Robot. Au départ, lorsqu’on s’est écartés de la colonne, je m’étais mis dans une position que pouvait justifier un besoin naturel m’obligeant à m’écarter de la colonne. Ensuite, on était bien ennuyés. Je réfléchissais à ce que je pourrais inventer s’ils nous avaient retrouvés. On aurait essayé de jouer l’humour. Il m’avait fait promettre avant de partir de lui donner ma radio, je lui aurais dit : « Je suis revenu parce que j’ai oublié de te la laisser… » Mais il est très difficile de savoir, puisque nos rapports étaient en permanence faux et hypocrites, comment ils auraient réagi réellement.
Est-ce que vous avez pensé qu’ils pourraient éventuellement se venger sur les autres otages ?
Nous n’aurions certainement pas envisagé une évasion si nous avions eu dans notre groupe d’autres otages occidentaux. Le sort des otages évangélistes philippins du groupe de Jesus Miracle Crused ne pouvait pas du tout être confondu avec le nôtre. Il ne pouvait pas y avoir de représailles sur les otages philippins quant à notre départ. Mais s’il y avait eu d’autres Occidentaux avec nous, il aurait été absolument inconcevable de mettre en danger la vie ou même ne serait-ce que les conditions de détention de nos collègues en essayant de fuir soi-même.
Qu’est-ce que vous pensez de l’attitude des gouvernements dans une aventure comme celle-là ? Certains disent qu’il ne faut pas négocier, d’autres pensent au contraire qu’il faut entreprendre des pourparlers très rapidement. Avec votre expérience, quel est le conseil que vous donnez à des chefs de gouvernement, à des hauts diplomates dans de telles crises ?
Je considère que les affaires d’otages ne sont pas des histoires très importantes. C’est finalement un risque de mort pour trois ou quatre personnes, et pendant que nous étions otages, il y a eu des accidents d’avions, de sous-marins, des drames sur les routes, tout un tas de personnes qui ont été plongées dans le malheur sans autre forme de procès. Simplement les affaires d’otage défraient la chronique parce qu’il n’y a pas de fatalité, et on a la chance d’appartenir à un pays qui considèrent la vie de ses ressortissants comme une valeur suprême et qui la défend. Mais comme toutes ces affaires qui ne sont pas véritablement graves, je crois qu’il faut les traiter à moindre coût. Alors, s’il faut envisager une opération militaire, des avions, des bateaux, des hélicoptères, mettre la vie de soldats en jeu sans être tout à fait sûrs de récupérer les otages vivants, le tout loin du territoire français, c’est très coûteux, et très dangereux. Cependant, ne rien faire et risquer la vie des otages, cela peut se révéler délicat pour un gouvernement en terme d’opinion, de sondage, d’élection. Alors, le moins cher, c’est de payer, mais il ne faut pas le dire, le faire très discrètement, et surtout que ce soit très compliqué. C’est de la diplomatie, on peut toujours enrober le paiement d’une rançon par des intermédiaires qui y trouve leur compte.
Quels sont vos sentiments à l’endroit des gens qui vous ont privé de liberté durant deux mois et demi ?
Ce sont des crapules, ce sont des bandits, des pirates… Mais ils ne m’ont pas mal traité, ils ont fait leur business sans être humiliants. Évidemment, ils nous ont plongés dans l’angoisse, et je pense plus particulièrement à tous nos proches, pendant ces soixante-quatorze jours. Il y a ce doute dans lequel vous êtes installé qui est absolument horrible et dans lequel vous installez votre entourage. Mais il n’y a pas d’animosité. Il y a bien sûr quelque chose de très malsain qui se met en place, c’est dangereux. Je suis très malheureux pour tous les mômes qui ont été pris dans cette mouvance, parce qu’on a annoncé dans une dépêche que cent dix-sept rebelles avaient été tués depuis notre départ. Dans ces cent dix-sept rebelles morts, il n’y a forcément pas les leaders mais tous ces gosses qui avaient entre quinze et vingt-cinq ans, qui vivaient autour de nous, qui étaient entrés là-dedans un peu par accident, qui nous préparaient le feu, et qui sont complètement paumés. Il y a deux situations : il y a les gosses qui ont été plongés dans cette histoire, et puis il y a les ravisseurs qui, eux, en faisaient leur business, commençaient à planquer leur argent et essayaient de faire en sorte que les négociations financières leur rapportent personnellement le plus possible. Ceux-là avaient finalement assez peu de préoccupation pour le sort de tous ces jeunes qui venaient les rejoindre.