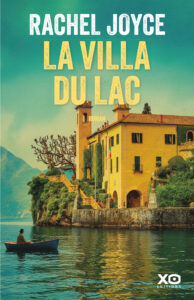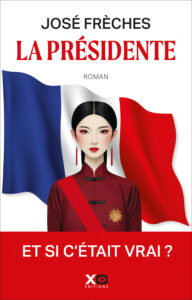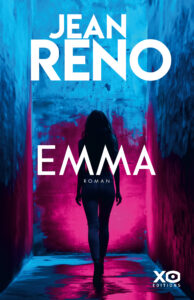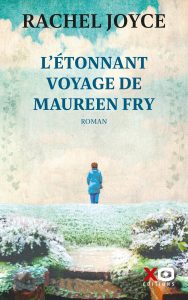Interview de l’auteur
Cavale est votre second roman. Comment le définissez-vous ?
C’est un roman qui, à travers une histoire d’amour, joue avec les ressorts dramatiques du secret. Ce que j’ai voulu, c’est rendre l’urgence du personnage, de sa quête. Jeanne est en danger de mort, pas seulement parce qu’elle se sent poursuivie, mais parce que le secret, le non-dit et la culpabilité sont en train de la tuer à petits feux. La découverte d’un crime joue, pour elle, comme un point de bascule. J’aime bien cette idée des bascules dans la vie. Parfois elles sont flagrantes et vous bousculent avec brutalité, parfois elles sont insidieuses, presque inaperçues. Le thème de la fuite, du départ, m’a toujours fascinée. L’idée de claquer la porte, de tout changer, parfois même en « bonne ménagère ». Tout est net, propre, rangé, définitif. On tourne la page et il n’y a plus de retour en arrière possible. Cela, sans doute, est la part la plus féminine du roman, la capacité qu’ont les femmes à partir. Peut-être que je me fais une image idéale de ces fuyardes courageuses, mais il faut de la témérité pour vouloir tout changer et foncer droit dans l’inconnu. Ses fuites m’apparaissent moins comme des débandades que comme des renaissances.
L’intrigue à suspense qui sous-tend le roman vous permet d’aborder des thématiques plus intimes, plus psychologiques, comme les secrets de famille, l’identité, la gémellité ou bien encore la fuite. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Les secrets de famille sont fondateurs de nos histoires, de nos vies. Nous portons tous des traces générationnelles, et c’est un formidable réservoir à histoires. Le personnage d’Anne, la jumelle de Jeanne, s’est imposé au fil de l’écriture sans que je la voie venir. Ce qui m’intéressait, c’était de parler d’un lien assez fort pour qu’il colle à la peau et contienne une violence potentielle, l’idée du double, l’altérité et, en miroir, l’identité. Qui suis-je, qui es-tu ? Ces questions-là nous hantent. Parfois, répondre à la seconde donne l’illusion de savoir qui nous sommes, par une sorte de raccourci. Ce n’est pas entièrement faux ni jamais suffisant, bien sûr.
Votre héroïne, Jeanne, est, au début du roman, une femme fragile, « morcelée », qui doit affronter la violence du monde extérieure. Mais finalement ne doit-elle pas affronter une autre forme de violence plus intérieure cette fois-ci, et dont elle se protège par l’amnésie ?
Jeanne est un personnage de femme assez chahutée par la vie. Elle a tenu longtemps sans flancher, comme un bon petit soldat, jusqu’à ce que cet événement extérieur brutal – un crime – lui fasse lâcher prise. L’amnésie dont elle est victime est une façon de parler des illusions auxquelles on s’accroche, de la force du déni, des violences intérieures que l’on s’inflige parce que l’inconnu semble bien plus redoutable qu’une douleur familière. Cet « instinct de la caverne », si j’ose dire, peut parfois enfermer dans des existences insatisfaisantes ou tragiques. Ce qui m’intéressait, au contraire, avec Cavale, était de raconter la possibilité de fuir non pas seulement pour s’échapper mais pour se décider à sauter dans le vide. Avec cette question : va-t-on chuter ou s’envoler ?
Pendant sa cavale, Jeanne trouve refuge dans un petit hôtel de Biarritz où elle va croiser des personnages singuliers, notamment Emil. Parlez-nous un peu de ce veilleur de nuit norvégien pas comme les autres ?
En envoyant Jeanne à Biarritz, qui est pour moi un lieu d’enfance heureux, je l’ai mise en lieu sûr. Je voulais un hôtel qui soit comme une coquille, ou un théâtre miniature rassurant dans lequel Jeanne pourrait reprendre souffle, un endroit qui soit à la fois un refuge et une porte sur le monde. Le personnage d’Emil, lui, est d’abord né de la nécessité de sortir de la tête de Jeanne et de la voir à travers le regard d’un autre. Et cet autre, sans que je le décide vraiment, devait être étranger. Pourquoi norvégien ? Je ne connais pas la Norvège, mais j’aime la littérature scandinave, et le défi que représentait ce personnage m’a plu. Quant à l’amour qui surprend Jeanne, c’est le dernier – ou premier – élément de sa libération. Et d’une façon plus large, c’est le ressort absolu de nos histoires. Cela s’est imposé, au fil des pages. Que ce soit l’amour de soi – le plus difficile – ou l’amour de l’autre, il n’existe rien d’autre qui vaille la peine de vivre. Rien sans amour, pas de salut, pas de sens à la vie. Ni la gloire, ni le pouvoir, ni la violence des traumatismes, ni l’enfermement ne tiennent face à cet éblouissement, à cette paix. L’amour, dans Cavale, vient comme une évidence.
Votre écriture, puissante, est mise au service d’une tension narrative constante. Comment écrivez-vous ?
J’écris comme je voudrais peindre, par touches que je dépose successivement, que je travaille et retravaille jusqu’à obtenir une petite musique. J’ai besoin que ça vibre, et le rythme est essentiel pour comprendre. Les sens aussi. Il me semble que chez moi les mots passent moins par le cerveau que par le corps. Je dois ressentir l’émotion du personnage, le respirer, « rentrer sous sa peau ». Il y a aussi chez moi une grande part d’intuition, presque une volonté d’y aller à l’aveugle, sans savoir. J’aime par-dessus tout écrire les émotions, de façon presque animale. Comme lectrice, je suis assez peu perméable aux textes uniquement beaux, ou tellement travaillés et corsetés qu’ils ne respirent plus. Ils finissent par m’ennuyer, parce que je n’y trouve pas d’échos, et un monde sans échos est forcément un peu factice.
Quelle est la place de l’écriture dans votre vie ?
J’écris depuis longtemps : du théâtre, de la poésie, des nouvelles, des scénarios. Et ce désir d’écrire vient précisément de mes lectures. Je me suis construite avec les livres. Enfant, je lisais tout et n’importe quoi pourvu que les mots m’irriguent, me remplissent, me consolent, pourvu qu’ils donnent une forme au monde. Entre neuf et onze ans, je suis passée des Évangiles à Bob Morane. Et puis, à l’adolescence, cela a été Victor Hugo et très vite le choc russe, Dostoïevski. Ces livres majeurs vous rentrent dans la peau et vous fabriquent une vision du monde. Dans mon parcours d’auteur, Cavale, pour moi, est un tournant. J’ai mis quatre ans à écrire ce roman et il m’a accompagnée à un moment clef de ma vie personnelle. Il me donne l’impression d’avoir débloqué quelque chose et d’accéder à une autre fluidité. Dès que je le pourrai, je plongerai dans le prochain. Je ne sais pas encore quelle sera sa tournure, mais je peux presque le sentir approcher, une forme vague et quelques envies fulgurantes, des silhouettes, une enfant, et ces thèmes qui m’inspirent depuis toujours : l’enfance, la différence, l’exil…
lire toute l’interview